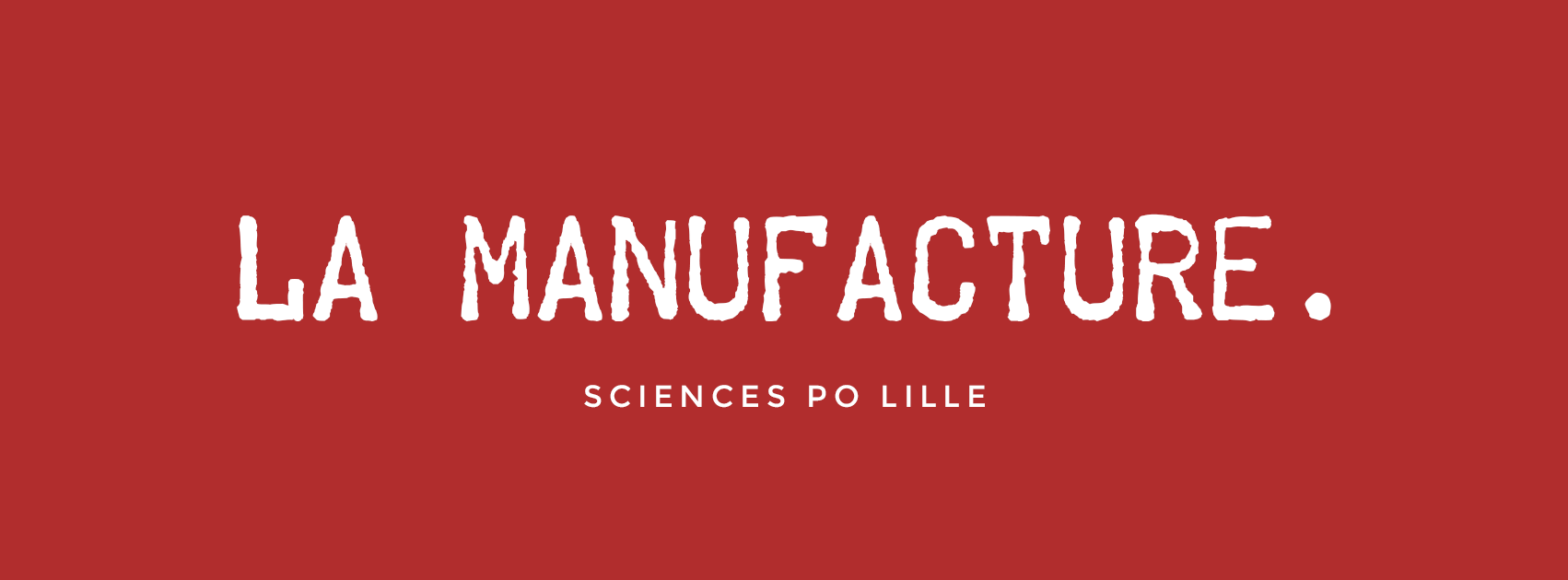Quelques heures de plus à Prague
Au matin, une hâte, une seule : joindre le centre pour profiter pleinement des quelques heures restantes. Premier novembre oblige, nous nous mettons en quête d’une messe et trouvons refuge christique dans l’église Saint-Havel du XIIIe siècle, d’abord style romane, sa basilique gothique du XIVe est quelque peu cachée par la façade baroque aménagée au XVIIIe. La messe est comble, et très traditionnelle, c’est un moment de répit partagé malgré nos approches différentes de la foi. Sur ce point, notons toutefois que la Tchéquie figure parmi les pays les plus athées/agnostiques au monde : plus de 60% de la population déclare ne pas appartenir à une religion, contraste notable avec leurs voisins polonais ou slovaques. Et ce contraste montre que cette dynamique de déclin du catholicisme ne date pas de la période soviétique. Wolfram Kaiser, professeur d’études européennes à l’Université de Portsmouth, en dresse une explication très intéressante : sous l’Empire austro-hongrois et après son démantèlement, l’anticléricalisme a accompagné l’esprit anti-autrichien du peuple tchèque qui s’est constitué en nation par opposition à la monarchie catholique des Habsbourg. L’essence du nationalisme tchèque est à trouver dans la résistance aux colonisateurs germains, qui cherchaient à établir leur domination par l’évangélisation.
Nous cassons la croûte dans une cantine de cuisine locale pour touristes, budget oblige. Nous y croisons deux Français, étant végétariens la carte les laisse dubitatifs. Pour nous ce sera porc frit et purée de pommes de terres. Profitons-en pour faire remarquer la surabondance de viandes présentées sur les marchés pragois : l’odeur des saucissons de cerfs et des grillades de sangliers déambule dans les rues et aguiche vos sens les plus délicats. Une fois rassasiés, nous décidons de conclure le voyage par une promenade dans l’historique quartier juif Josefov, ancien ghetto de la Vieille-Ville, marqué par l’histoire de la Bohème et de l’Europe. Remodelé et assaini au XIXe par une initiative de rénovation haussmannienne, le quartier semble privé d’une part de son passé. Néanmoins son musée, ses synagogues et ses étoiles de David carrelées au sol sont là pour authentifier ces lieux célèbres.
Enfin, avant que la nuit ne tombe, nous nous dirigeons vers une bretelle d’autoroute, l’occasion de passer une dernière fois par les « bloki », ces froids mais non moins somptueux édifices de mémoire populaire. Avec au cœur de la banlieue, cette gigantesque gare de métro offerte au peuple par le régime communiste. Si l’histoire en a balayé les dirigeants, ses traces demeurent vivaces ; et que penser du fait que ces blocs, « tristes et insalubres », sont aujourd’hui indispensables au marché immobilier incapable de se renouveler ?

L’ingénieur et la conscience de peuple
Nous revenons dans la banlieue de Prague pour rejoindre un endroit pratique où faire du stop en direction de l’Allemagne : le retour débute. Après une bonne heure d’attente sans nous décourager, une voiture s’arrête. Le conducteur, jeune ingénieur tchèque dont le prénom, hélas, nous échappe, rentre chez lui à Plzeň (moins d’une heure de route à l’Est) et propose par conséquent de nous conduire jusqu’à l’aire d’autoroute avant l’entrée de la ville. Suite à ses questions, nous lui racontons notre voyage et notre séjour à Prague, ainsi que nos impressions très positives de la ville. Il nous parle de sa vie : cadre ingénieur, spécialisé dans les barrages hydroélectriques, il habite à Plzeň avec sa femme et ses enfants, et travaille à Prague. Il apprécie davantage le calme de la vie à Plzeň, 170 000 habitants tout de même, au vacarme urbain de Prague. Son métier le fait voyager pour des périodes courtes, et il en a le goût : en février, il ira se rendre en Angleterre pour un projet de barrage. Il apprécie le fait d’aller étudier le terrain, d’être dans la nature et de mettre ses compétences à disposition du développement des énergies propres.
En réaction à notre récit sur la « nostalgie yougoslave » de nos amies slovènes, il nous livre sa réflexion sur l’histoire et la société des peuples slaves ; selon lui, la Yougoslavie, comme tout assemblage artificiel de peuples distincts, était vouée à l’échec, et la force de la Tchéquie résiderait dans le fait qu’elle soit une nation culturellement homogène. Aussi l’instabilité passée des Balkans résulterait des enchevêtrements réciproques de populations, dans un espace- mosaïque de religions et de langues nationales. « Nowadays, in our country, we don’t have any large foreign community ; those who come here are only tourists. », dit-il. Puisque nous évoquons la Tchécoslovaquie, il défend que les deux cultures ont une proximité extrême, mais que le peu de différences entre les Tchèques et les Slovaques a rendu leur séparation inéluctable en 1992. Toutefois, ce fût dans un divorce par consentement mutuel, doux et amical, à tel point que la séparation est surnommée « le divorce de velours ». Et en effet, quoi qu’on en dise, le fameux « on peut toujours rester amis » fonctionne : la Slovaquie est le deuxième partenaire commercial de la République Tchèque, précédée par l’Allemagne. Nous voilà arrivés près de Plzeň.

Manuel, l’irrésistible Allemand
L’aire d’autoroute tchèque nous paraît plutôt favorable : une station essence, un magasin, un restaurant et, surtout, des plaques d’immatriculation allemande. Nous commençons à aller voir les Allemands stationnés pour dîner. Nous tombons rapidement sur Manuel, qui revient d’un séjour entre amis à Prague, et rentre à Stuttgart dans la soirée. Un coup de chance, encore, d’avoir un trajet direct sur une si longue distance. Nous entrons dans sa belle BMW. Manuel a trente-cinq ans, il est consultant pour une entreprise de high-tech à Nuremberg ; il a un appartement dans sa ville de travail où il réside la semaine, mais revient à Stuttgart les week-ends dans son autre appartement. Il ne nous cache aucunement qu’il gagne beaucoup d’argent et qu’il mène une vie agréable, entre voyages pour le travail et voyages pour les vacances. Nous faisons face à l’archétype de l’« homme nomade », comme dirait Jacques Attali. L’attendions-nous ? La discussion tourne autour de l’argent, Manuel n’a aucun complexe vis-à-vis de son salaire, il l’attribue à son mérite personnel. Son discours est imprégné de la mentalité germanique et anglo-saxonne, il dégage « l’éthique du protestantisme » analysée par Max Weber, tandis que l’argent est encore, dans une certaine mesure, un tabou dans les « pays latins ». Bien sûr, le capitalisme s’est également développé en France où il régit désormais le système économique (et politique), mais il ne fait nul doute que l’esprit individualiste de l’Américain, de l’Allemand ou de l’Anglais en soit la source, ou la cause, profonde. Pour exemple, on imagine mal un candidat français gagner en déclarant « the beauty of me is that I’m very rich » ; au contraire, l’opinion publique en serait scandalisée.
Nous discutons tout le long du trajet avec Manuel. Amical tant que généreux, il nous offre quelques cigarettes d’une des cinq cartouches qu’il a achetées en Tchéquie. Il explique s’être bien habillé pour éviter de paraître suspect, à cause des substances illicites qu’il a consommées à Prague avec ses amis. Il regrette le fait que les prix à Prague soient montés terriblement ces trois dernières années, et nous explique qu’auparavant les séjours allemands en Tchéquie servaient d’échappatoire à la vie coûteuse. A titre d’illustration, le prix des appartements à Prague a augmenté de 23% par rapport à l’année dernière, et nous même avions remarqué l’extrême différence de prix entre le centre-ville touristique (pinte de bière à 5€) et la banlieue (autour de 1,50€). Prague fait partie de ces destinations « à la mode » depuis quelques années, au même titre que le Portugal ou la Croatie, et voilà que désormais les endroits « pas chers » réajustent leurs prix à la loi de la demande. On constate donc, dans ces pays-là, la toute-puissance du phénomène touristique par l’écart fulgurant des prix entre la ville, la banlieue et la campagne.
Nous essayons de lui décrire tant bien que mal Sciences Po Lille, les grandes écoles sur concours étant une exception française. « Selective university of political sciences », voilà une explication peu adéquate mais convenable, et par conséquent Manuel nous demande ce que nous pensons de la politique en France. Nous répondons assez vaguement qu’il y a de plus en plus de tensions, afin de ne pas entraver notre « neutralité » et pour qu’il reste honnête dans ses idées. A nous de lui renvoyer la question en ce qui concerne l’Allemagne. Sans trop de surprise, il nous lance qu’énormément de gens votent désormais pour le parti Alternative für Deutschland (AfD), phénomène très dangereux selon lui puisqu’il s’inscrit dans la dynamique occidentale de vote populiste de droite, et met en danger l’ouverture des frontières ainsi que le projet européen. « Jeune cadre dynamique » allemand, premier de cordée, Manuel pouvait-il penser autre chose que cela ? Nous défendons la précarisation du travail (7 millions de mini-jobs en Allemagne) comme éventuelle explication de ce vote, mais il nous rétorque que si les gens ont peur de perdre leur poste, soit à cause de l’immigration ou à cause de l’insécurité de l’emploi aujourd’hui, ils n’ont qu’à faire de meilleures études. Sa réponse est très intéressante – et très allemande, pour ainsi dire – d’autant qu’il ne s’arrête pas là : l’État allemand donne suffisamment d’aides, voire trop, nous explique-t-il, pour que chacun puisse ensuite s’en sortir en travaillant. L’immigration n’est en rien à blâmer selon lui : les immigrés font tous les métiers que les Allemands ne veulent plus faire. Ils sont donc utiles à la société, et ceux qui s’en plaignent doivent trouver de meilleurs boulots ou accepter leur sort. On pensera ce qu’on veut de ses opinions très libérales (au sens politique et économique), mais son discours n’est teinté d’aucune incohérence. L’individu doit se frayer un chemin dans la jungle économique de la société ouverte ; Manuel est en haut de la chaîne alimentaire, que les autres le rejoignent s’ils en sont capables.
Manuel s’enquit de la perception de l’Allemagne à l’étranger, qu’il pense très négative. Nous tentons de l’expliquer en invoquant les pistes du caractère strict et formel que peut inspirer la langue allemande, ou encore du rôle central – et dominant – de l’Allemagne dans l’Union Européenne. Mais Manuel se concentre sur une autre explication : « We were really fucked up in the past. ». Il défend que l’Allemagne a fait beaucoup d’efforts pour se racheter et continuera à faire de la sorte. La tolérance est donc un gage de bonne conduite pour le cadre supérieur allemand, avant d’être une idée personnelle ; il s’agit en effet de ne pas tomber dans des opinions qui pourraient ressembler aux vieux travers d’antan sous peine de mort sociale, et c’est dans cette catégorie de « non-fréquentables » qu’il classe les marginaux de l’AfD. L’Allemagne, et c’est compréhensible, a du mal à regarder son passé. Pour compléter cela et mettre tout le monde sur un pied d’égalité, nous lui disons simplement que la France avait également sa part dans les torts de la Seconde Guerre mondiale.
Sur ces échanges très riches, nous nous quittons à l’aire d’autoroute avant Stuttgart. Manuel, encore généreux, nous offre sa carte et un paquet de cigarettes avant de disparaître au loin dans sa BM. Quelle classe ! Nous marchons un peu en direction de la campagne et plantons la tente près d’un champ.

Gunter, le fermier
Au petit matin, nous sommes réveillés par des aboiements de chien et par une voix d’homme qui crie « Bib-bip ! » de manière cadencée. Ouvrant la tente, nous découvrons le visage d’un fermier accompagné de son chien à une vingtaine de mètres de nous. Il reste immobile et nous fixe, un râteau à la main. Aïe, doux réveil. Nous décidons de ranger nos affaires et de déguerpir au plus vite ; lorsque nous sommes enfin habillés et que nous sortons de la tente, il a disparu. Un brave homme des champs somme toute.
Miroslav, le travailleur bulgare
De retour sur l’aire d’autoroute, nous petit-déjeunons à base d’une salade thon-maïs que nous avions confectionnée chez Ester… Et nous recommençons d’emblée à faire du stop à la sortie. Un Bulgare s’arrête et nous dit qu’il va vers Mannheim, nous lui demandons donc de nous déposer un peu avant Karlsruhe, à quelques kilomètres de la frontière française. Il parle très mal anglais, mais tente malgré cela d’entamer une conversation, et nous parvenons à le comprendre avec un peu d’effort.
Il travaille en Allemagne depuis six ans (actuellement chauffeur de taxi), et affirme qu’il déteste les Allemands « because they are Nazis ». Nous avons l’impression d’une suite logique entre notre trajet avec Manuel et la rencontre de ce Bulgare. Naturellement, nous lui demandons plus de détails, qu’il nous livre sans problème : il les trouve désagréables, et il ne parvient pas à s’adapter à une société qu’il méprise de toute son âme. Après lui avoir demandé s’il connaissait beaucoup d’autres Bulgares ici en Allemagne, il nous répond positivement ; d’ailleurs, il vit avec sa sœur à Stuttgart depuis ces six années. Selon lui, ils sont de nombreux Slaves à travailler en Allemagne pour les salaires plus attractifs, et vivent surtout en communauté afin de s’entraider. En effet, l’Allemagne comptait environ 800.000 Polonais, 360.000 Croates et 310.000 Bulgares en 2012 (Statistisches Bundesamt). Il désire néanmoins revenir en Bulgarie dans un avenir proche. Il exprime également son mépris pour les Turcs, en invoquant la grande croix qui pend au-dessus de son pare-brise. Nous ne saurons pas s’il s’agit d’un cas exceptionnel, toujours est-il qu’il illustre bien les tensions intercommunautaires qui peuvent exister en Europe. Malheureusement, notre inattention et son mauvais anglais font en sorte que l’on dépasse Karlsruhe au Nord, en direction de Mannheim. Nous lui demandons de nous déposer à tout prix à la prochaine station-service. Là commence l’embourbement.
Les aléas du voyage…
Nous voilà donc sur une station- service, mais dans le mauvais sens… Cependant nous avons un peu de chance : il y a une autre aire de l’autre côté de l’autoroute (direction Karlsruhe), et nous apercevons un pont au loin, qui nous permettrait de traverser de l’autre côté. Nous entamons la marche, et arrivons quelque temps après au bon endroit pour faire du stop et rattraper le temps perdu.
La journée devient très longue : les seules personnes allant en direction de la France, un couple de hippies en caravane, refusent de nous prendre. Avec les heures qui défilent, nous nous mettons d’accord pour accepter n’importe quel trajet pour peu qu’il nous sorte de cette situation et tant qu’il reste sur l’axe vers la frontière. Une voiture s’arrête ; le conducteur nous propose le trajet contre de l’argent, ce n’est pas dans le projet. Après encore un peu de temps, le conducteur d’une camionnette, allant « dans la région », propose de nous prendre en nous assurant que cela facilitera notre retour en France. Nous acceptons malgré l’imprécision. Dans la camionnette, le conducteur est très sympathique, nous offre des pâtisseries, mais parle très mal anglais, et quand nous lui demandons de nous remettre sur l’axe adéquat il insiste pour nous emmener à Pforzheim afin que nous y prenions un train, ce dont il est hors de question. Or, Pforzheim est dans la direction de Stuttgart, nous revenons sur nos pas malgré nos insistances qu’il fait mine de comprendre. « Quand on est con, on est con », chantait Brassens. Il finit enfin par nous laisser dans la zone commerciale de Pforzheim, sans doute le pire endroit pour faire du stop. Gentil mais complètement abruti ; notre frustration nous renvoie aux mots de Mauriac selon lesquels « une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison ». Parce qu’un malheur en appelle un autre : nous avons perdu un pull, et notre pot de petits pois carottes explose dans un sac, nous en porterons l’odeur tout le voyage. Une demi-journée de poisse donc.
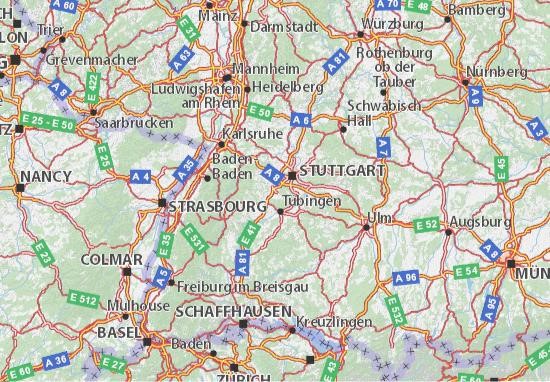
Comment rejoindrons-nous enfin la Mère Patrie ?
Jean Tiers-Monde et Matthieu Alzuyeta.