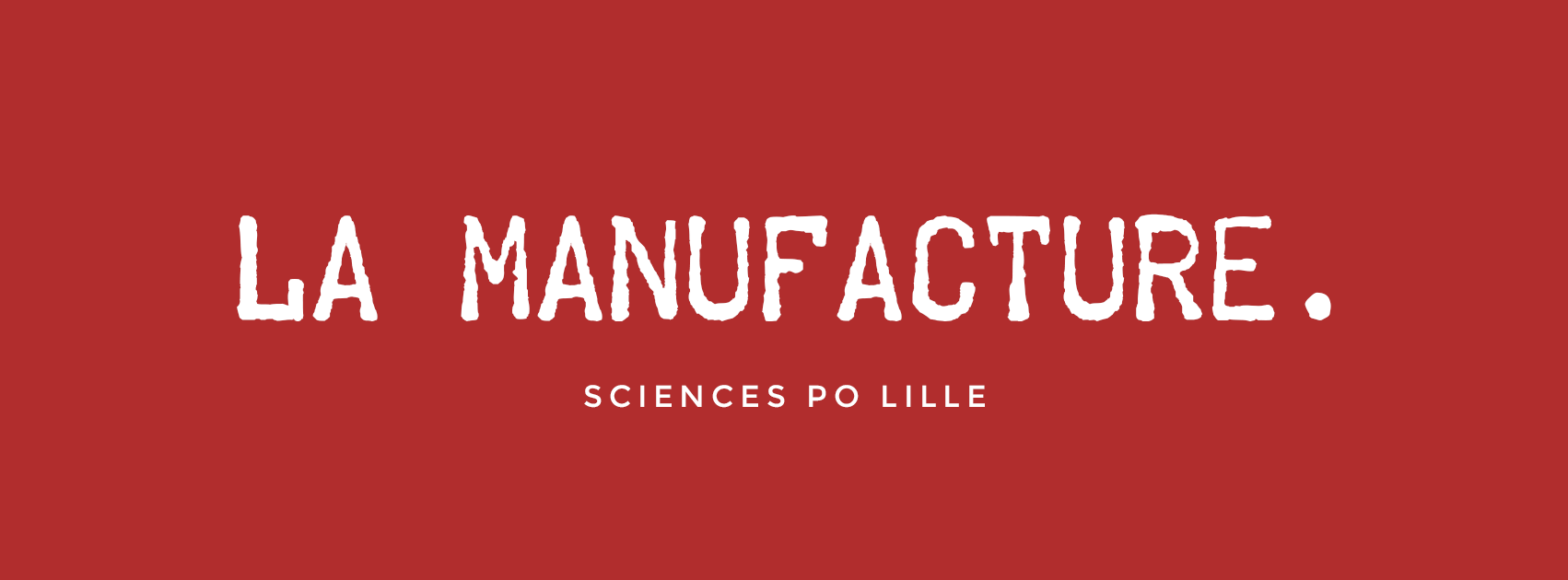L’officialisation de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête de l’Algérie est loin d’avoir fait retomber la pression de la rue. La Manufacture s’intéresse aujourd’hui au fonctionnement du pouvoir algérien, aux différentes formes de la contestation et aux scénarii de sortie de crise possibles.
Crise, népotisme et Constitution à la carte
Voilà deux semaines que des milliers d’Algériens ont donc investi les rues des principales villes d’Algérie, dont la capitale, Alger, mais aussi des villes de province à l’image d’Oran ou Sétif. Le mot d’ordre ? Un changement de président à la tête de l’Algérie, dirigée depuis 1999 par Bouteflika. L’actuel président, et candidat à sa succession, aujourd’hui âgé de 82 ans, s’est vu remettre les quelques 60000 bulletins de parrainage, indispensables pour le dépôt de candidature devant le Conseil Constitutionnel, en vue de l’élection du 18 avril prochain.
Pour comprendre l’ampleur des manifestations, qui touchent à la fois les milieux étudiants comme les classes moyennes, il faut s’intéresser aux arcanes du pouvoir, et plus précisément à la source politique du fonctionnement de l’Algérie : la Constitution. L’actuelle Constitution date de 1996, mais elle a été révisée à de nombreuses reprises dont la plus importante a eu lieu en 2016. Elle énumère, par le biais de son article 85 que “Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.”
“L‘élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi organique.” Voilà pour la théorie. Dans la pratique, le bourrage d’urnes est monnaie courante et de tels soupçons ressurgissent lors de chaque élection, notamment lors des législatives de 2017. Par ailleurs, il est à noter que n’importe qui ne devient pas président. De nombreuses conditions restreignent le droit de se présenter aux présidentielles, en le cantonnant qu’à une petite minorité élitiste du pays. On retrouve parmi ces obligations, l’impératif de ne pas “avoir acquis une nationalité étrangère“, d’être “de confession musulmane“, d’avoir “40 ans révolus au jour de l’élection” ou encore de “justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix années précédant le dépôt de la candidature“. Logiquement, le président ne peut pas faire plus de deux mandats successifs à la tête de l’Algérie depuis la réforme de 2016. Au pouvoir depuis 1999, Bouteflika aurait donc dû passer son tour. Oui, mais le Conseil Constitutionnel a formellement indiqué que la loi entrerait en vigueur qu’à l’issu des futures élections… qui auront (probablement) réélues Bouteflika pour 5 ans. Notons de plus, que les 60000 signatures de parrainage indispensables à la candidature, sont loin d’être obtenues par tous les candidats et constituent un filtre supplémentaire. On comprend donc qu’à l’inverse des Etats libres et démocratiques, ce n’est pas le politique qui se plie à la Constitution mais bien la Constitution qui se plie aux exigences du pouvoir et du Conseil Constitutionnel qui en modifie les articles sans passer par un vote populaire, mais par un vote des deux chambres, largement acquises au camp du président. Certes, plusieurs candidats se présentent à cette élection. C’est le cas d’Ali Ghediri, un ancien général à la retraite ou bien le riche homme d’affaire Rachid Nekkaz. Mais ces candidats apparaissent davantage comme des marionnettes pour mettre en avant un semblant de démocratie, la légitimité étant largement acquise à Bouteflika.
Un autre élément, plus profond encore qui explique l’importance des atteintes portées à l’égard de la Constitution, sont les soupçons aujourd’hui presque assumés par le pouvoir de népotisme avec le milieu de affaires et celui de l’Armée. Autour de la personnalité de Bouteflika gravite en effet une véritable nébuleuse, un “clan” d’hommes d’affaires et de membres de la famille qui ont comblé le vide causé par l’absence du président, depuis son AVC en 2013. Parmi eux, on retrouve Ali Haddad, présenté comme le trésorier officieux de la campagne à venir. A la tête du Forum des chefs d’entreprise, cet homme a bâti sa fortune grâce à la corruption qui frappe le pouvoir et en obtenant des apports financiers d’entreprises favorables à Bouteflika. Il fait partie de cette caste, qui en lien avec le pouvoir, s’est arrogée une grande partie des richesses du pays, principalement grâce à la manne pétrolière. Il n’est pas le seul loin de là. Saïd Bouteflika, frère aîné de l’actuel président, a vu sa popularité augmenter de façon inversement proportionnelle à la dégradation de la santé d’Abdelaziz Bouteflika. Il est régulièrement approché pour prendre des décisions qui relèvent de la compétence du chef de l’Etat, comme le limogeage ou la nomination de hauts responsables à la tête de l’Etat. Le site France 24 a recensé au total près d’une douzaine de personnalités gravitant autour du président. Leur point commun : elles ne sont pas élues, mais influencent voire agissent à la place d’un président affaibli pour prendre des décisions. Il est là, le fond démocratique du problème.
La question purement politique n’est qu’un des aspects de la crise. Une grande partie de la contestation tire son origine de la crise économique que traverse le pays. Les années 90, bien que marquées par la guerre civile (1991-2002) étaient des années de fortes prospérités économiques. L’augmentation des cours du baril de pétrole a permis au pays d’appliquer une politique de redistribution qui a augmenté le niveau de vie des algériens. Mais pour un pays rentier comme l’Algérie dont les exportations dépendent à 95% de la manne pétrolière, la baisse des prix du baril à partir de 2014 a provoqué une crise structurelle.
Manifestations inédites et poids démographique
Les manifestations qui secouent le pays depuis deux semaines sont loin d’être les premières qu’ait connu le pays, mais elles sont inédites à plus d’un titre. D’abord elles auraient rassemblées plus d’un million de personnes le 2 mars dernier, un chiffre record depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, la forme de la mobilisation est aussi inédite. Elle a fait appel aux réseaux sociaux dont Facebook qui a œuvré pour coordonner les manifestations. Cette mobilisation aussi intensive des réseaux sociaux avait déjà été remarquée lors des Printemps Arabes qui n’avaient cependant pas touchés l’Algérie avec la même intensité que les autres Etats du Moyen-Orient. Les réseaux sociaux ont repris certains mots d’ordre à l’encontre de Bouteflika qui avaient émergé à l’origine… dans les stades de foot, où des banderoles hostiles à la candidature du président avaient été déployées. Face aux interdictions de manifestation mises en place par le régime ainsi que celle de placarder dans la rue des appels au rassemblement, les réseaux sociaux sont devenus des espaces alternatifs sur lesquels s’est exprimé la colère du peuple algérien. Autre point important, selon Habib Brahmia membre du collectif d’opposition Mouwatana, les réseaux sociaux ont permis de pallier au manque de contre-pouvoirs en Algérie dont celui des journaux, peu enclins à montrer la réalité des manifestations.
Cependant dans la grande majorité des cas, ces manifestations se font sans violences. Les réseaux sociaux sont d’ailleurs devenus des relais pour diffuser des messages d’apaisement afin d’éviter un embrasement généralisé de l’Algérie. Ce relatif pacifisme au sein des manifestations s’explique aussi et surtout par le souvenir traumatisant de la guerre civile qu’a connu le pays de 1991 à 2002. Le gouvernement et plus précisément l’armée avaient alors interrompu le processus électoral des élections législatives qui avaient lieu face à la perspective d’une victoire de groupes islamistes, dont le Front Islamique du Salut. Une guerre civile longue de 11 ans avait déchiré le pays, opposant le gouvernement à divers groupes islamistes dont le FIS mais aussi le GIA, le Groupe Islamique Armé. Cette guerre et ses cicatrices restent dans les mémoires des plus anciens et expliquent la volonté des manifestants de ne pas recourir à la force, pour une population qui semble déjà “vaccinée” face au fléau de la violence.
Le point commun de l’ensemble de ces caractéristiques propres à la contestation actuelle, c’est le poids de la démographie et la force de la jeunesse. L’âge médian algérien atteint 28 ans chez les femmes et 27 ans chez les hommes tandis que la part des 0-14 ans représente plus de 25% de la population nationale. Il s’agit donc d’une génération qui n’a pas connu la “décennie noire” (la guerre civile), mais qui s’est en revanche familiarisée avec l’utilisation des réseaux sociaux. La part des moins de 25 ans représente un quart de la population totale, autrement dit toute une génération qui a seulement connu Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. La jeunesse constitue donc une clé du scrutin du 18 avril prochain, un scrutin qui risque cependant d’être marqué par une forte abstention.
Répression, alternative ou élection ?
La répression semble l’hypothèse la moins crédible. Jusqu’alors, les manifestations n’ont point dégénéré au point de mobiliser une répression musclée de la part du gouvernement ; bien que l’armée ait proclamé son souhait de préserver la stabilité du pays. En réalité, il apparaît que le régime cherche à gagner du temps pour tenter d’apaiser à terme la colère, dont nous venons de déceler les origines profondes. La perspective d’une répression semble d’autant moins crédible, encore moins celle d’une guerre civile, dans la mesure où les cicatrices des guerres passées sont toujours présentes et que les conséquences d’un tel affrontement auraient des répercussions sur le plan sanitaire, humanitaire et migratoire avec en ligne de mire les côtes européennes.
L’hypothèse de l’alternative semble encore moins crédible. D’abord parce que même en temporisant, le gouvernement n’arrivera pas à trouver un autre candidat que Bouteflika. L’armée et le FLN ne prendraient pas le risque d’élire un autre candidat qui n’a jamais exercé le pouvoir auparavant et dont les idées et les intentions ne sont pas clairement définies. Une hypothèse d’autant moins probable, que paradoxalement, l’occupation du pouvoir par le “clan” Bouteflika constitue un rempart face à la montée en puissance des réseaux islamistes. Le risque serait alors de revivre la crise qui mena à la guerre civile des années 1990.
L’hypothèse la plus crédible à ce stade reste donc celle de l’élection : le 18 avril prochain, peu de doute que Bouteflika sera réélu. Mais à quel prix ? Nul doute non plus que l’annonce d’une réélection de l’actuel président ne fera qu’accroître l’ampleur des manifestations. Une éclaircie cependant : Le chef de l’Etat a promis, de ne pas aller au terme de son mandat, s’il est réélu. Il promet également d’organiser une “conférence nationale” à l’issue de laquelle sera adoptée une nouvelle Constitution et organisées des élections présidentielles anticipées, auxquelles le président a promis de ne pas participer. Derrière les promesses, il y a une institution essentielle qu’est le Conseil Constitutionnel. A lui d’honorer ou non l’ouverture démocratique du pays en ne s’autorisant plus à modifier les contours de la Constitution selon son gré et en permettant d’assurer la transition démocratique post-Bouteflika.
Avec lui, l’Algérie est peut-être au tournant de son histoire.
COULON Baptiste