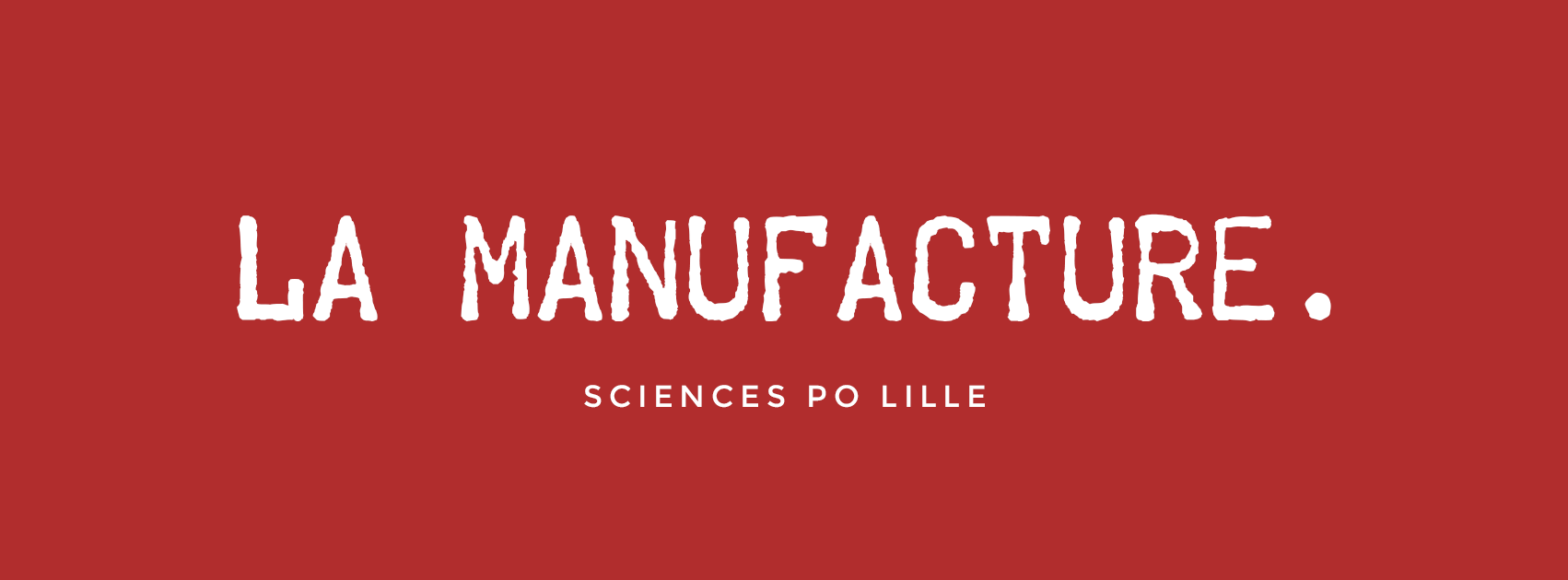Dans le cadre de la semaine du handicap à Sciences Po Lille, L’Association Sportive recevait, en collaboration avec l’Association de Santé publique, Julien Soyer. Cet ancien pongiste handisport international, et désormais journaliste sportif nous a accordé un bref entretien en amont de sa conférence portant sur le thème des évolutions du monde du handisport et de sa médiatisation.
Julien Soyer fut amputé à l’âge de six mois de la totalité de sa jambe droite suite à une polio contractée en Inde, son pays de naissance. Il porte ainsi une prothèse complète. Après l’avoir défié sur la table de ping-pong pendant plus d’une demi-heure, nous avons pu échangé sur son parcours depuis son plus jeune âge : ses réussites sportives, sa carrière journalistique, les regards sur son handicap… Rencontre avec cette personnalité attachante.
Vous étiez pongiste handisport, que pouvez-vous retenir de votre carrière de haut niveau ?
Julien Soyer : Alors déjà des rencontres, tout ce qui est lié à l’extra-sportif finalement. Cela m’a donné la chance de parcourir le monde entier. J’ai pu aller aux États-Unis, en Australie, aller à Nouméa avant les Jeux de Sydney. Donc, en terme humain, c’était des expériences extraordinaires.
Après, sportivement, il y a la joie et la satisfaction de gagner des médailles et des matchs importants. Mais, parce que cela récompensait un travail acharné et des démarches volontaristes dans l’entraînement, dans la mise en place de l’accès au haut niveau handisport. À l’époque, on n’avait déjà pas les mêmes conditions que les valides. Du coup, on devait être en mesure de trouver une organisation et des fonds pour pouvoir se préparer au mieux, se qualifier pour les épreuves majeures. Pour faire les JO ou les championnats du monde, il fallait faire partie des dix-huit ou vingt-quatre meilleurs mondiaux.
Et on ne pouvait figurer dans ce top là qu’en participant à des compétitions intermédiaires qui sont à la charge du joueur. C’est-à-dire qu’il fallait avoir une réflexion globale sur la vie du sportif de haut niveau et être commercial dans l’âme pour pouvoir se vendre auprès de sponsors et collectivités et mettre en place toute une stratégie de communication.
Quand on est handicapé quasiment depuis sa naissance, comment fait-on pour devenir sportif de haut niveau ? Est-ce qu’on doit pratiquer avec des valides ? Comment est-on reçu par les fédérations ?
JS : Il n’y a pas de parcours identiques. Moi, j’ai débuté le tennis de table par le handisport, ce qui est assez rare. Souvent, on commence par affronter les valides. Ça a été un peu l’inverse pour moi. Je suis fan de foot et je voulais y jouer à tout prix. Jusqu’en pupille à sept, j’ai joué avec les valides au football. Et puis quand les buts ont grandi, moi je n’ai pas beaucoup grandi… (rires), par contre l’appareillage est devenu de plus en plus imposant. Plus aucune assurance ne voulait me prendre en charge. Après, il y a eu toute une recherche pour continuer à pratiquer le sport. Et, un jour, j’ai fait un tournoi de ping-pong non licencié dans mon petit village. Quelqu’un est venu me proposer d’essayer le handisport. C’était la première fois, j’avais 13 ans, que je me retrouvais confronté au milieu du handicap et qu’on me considérait comme un handicapé.
Et comment avez-vous vécu ce nouveau regard des autres ?
JS : J’ai grandi dans une famille de cinq enfants, tous valides. Pendant un moment, j’étais même le seul à avoir une chambre à l’étage chez nous (rires). On n’avait jamais de différences dans notre famille sous prétexte que j’étais séquelle de polio. Ce nouveau regard des autres concernant le handicap m’a fait bizarre… après ma première compétition, j’ai dit à mes parents : “plus jamais je ne reviendrai, ce n’est pas possible de jouer contre des gens qui n’ont pas de bras”. Là, y a eu, une série d’opérations qui n’étaient pas prévues dans mon cursus de croissance, après lesquelles j’ai repris la compétition. J’ai rencontré deux personnes qui avaient fait les JO de Barcelone (1992) et qui se destinaient à aller à Atlanta (1996), elles m’ont prise sous leurs ailes. Ça a été super motivant qu’ils voient quelque chose en moi, et des perspectives de carrière handisport. J’ai alors eu mes premiers résultats avec les valides, et parallèlement j’avançais en handisport. Et comme il y a moins de concurrence et que le niveau est différent, je suis devenu international handisport.
Vous parliez des difficultés d’accès au haut niveau handisport, peut-on aujourd’hui en vivre totalement ? Et quel regard portez-vous sur les évolutions dans le monde pro handisport ?
JS : Globalement, ça a énormément évolué. Pas encore assez vite, mais ça prend la bonne direction. Ça se voit notamment en terme de médiatisation, au moins sur les JP (Jeux Paralympiques ndlr) où on a un suivi. Depuis 2014 (JP Sotchi ndlr), on a même la chance d’avoir des directs sur nos épreuves. (Avec Julien Soyer en consultant s’il-vous-plaît !) Cela contribue à favoriser la reconnaissance du sportif handi, et par extension l’accès à plus de moyens. A défaut de devenir professionnel et d’en vivre véritablement, beaucoup d’entre nous arrivent à obtenir des contrats d’images et qui bénéficient de détachements et d’aménagements, notamment à l’approche des grandes compétitions. Il y a toujours un enjeu financier sur les compétitions mais de plus en plus, la fédé (fédération ndlr) et les institutions nationales apportent des aides. Les comités régionaux aussi.
Et comment évalueriez-vous les évolutions en terme de performances sportives ?
JS : Souvent, on me dit que le niveau handisport aujourd’hui, il est énorme. Et que je ne serais absolument pas au niveau, et c’est vrai. Mais aussi, les mecs aujourd’hui, pour arriver à s’entraîner correctement, ils n’ont pas du tout autant d’obstacles que nous on en avait. J’ai passé mes étés à courir les stages parce que les salles de sports étaient fermées près de chez moi. J’habitais à Nantes mais j’allais faire des stages à Agde, à Metz ou à Bruxelles… et tout cela à ma charge. Par exemple, lors de mes premiers championnats du monde 1998, j’ai même dû payer 50% de l’équipement France. C’était il n’y a pas si longtemps et aujourd’hui ça paraît inconcevable pour nos sportifs qui préparent les JO de Tokyo.
Pour le grand public, on voit souvent comme une fierté le fait de porter le maillot français. Et vous, comment avez-vous vécu votre première sélection ?
JS : Déjà, la première sélection c’est juste énorme. J’espérais être sélectionné aux championnats d’Europe 1995, et je n’ai pas été pris. Ça a été une énorme désillusion. Et en 1997, j’ai été pris. Mais là je m’y attendais, ça aurait été un scandale si je n’avais pas été pris. C’est surtout quand on arrive pour la première fois dans une salle internationale que l’on ressent quelque chose. Il y a une pression, il y a des regards différents. C’est quand même un truc à part à vivre, notamment une dotation France, même si à l’époque j’avais dû en payer une partie (rire). Porter le maillot France, c’est quelque chose de fort.
Et les deux médailles paralympiques ?
JS : Les deux médailles paralympiques, avec du recul, c’est génial. Mais sur le moment, quand tu es en argent sur le podium, tu es le seul à avoir perdu ton dernier match. Donc t’es le seul à tirer la gueule. Et moi je tirais la gueule car j’étais super déçu. Les premiers en 2000 contre la Corée, c’était mérité même si j’étais déçu. Mais, la deuxième (en 2004, à Athènes ndlr), alors là, j’étais inconsolable parce qu’on jouait la Belgique en finale et on n’avait jamais perdu les Belges par équipe. On savait qu’avec eux tout se jouait sur le double, et en double, on était intraitable. Et c’est avec ce match qu’on voit aussi les différences de considération pour le handisport parce qu’on a eu un problème de climatisation dans la salle… aux Jeux. Alors ça paraît être une excuse bidon mais on jouait avec du vent ! On a utilisé tous nos temps morts pour ralentir le jeu et stopper le match. Mais, à cause des protocoles et des finales derrières, on a dû jouer. On a dû changer de côté pendant la dernière manche, la belle. On gagnait 5-1, on finit par perdre 11-6.
Vous parlez des émotions que vous avez pu ressentir en tant que pongiste, est-ce que vous arrivez à les comparer à celles que vous procure le suivi des JO en tant que journaliste ?
JS : C’est très différent. L’avantage des Jeux en tant que journaliste, c’est qu’on gagne et qu’on perd plein de fois. On est chauvin. On ne joue pas qu’une seule médaille, mais plusieurs. Et la différence aussi, c’est que ma compétition à moi maintenant, c’est de répondre aux exigences du journal. Et j’espère surtout qu’à la fin, le journal, par les retours qu’il va avoir, ne regrettera pas de m’avoir envoyé sur place. J’espère qu’ils se diront qu’ils sont gagnants, que je leur ai apporté un truc, une plus-value.
En un mot, avec votre handicap depuis la naissance, votre plus grande fierté restera d’avoir réussi à percer dans le sport ou dans le journalisme ?
JS : Les deux. Je me suis construit grâce à l’un et grâce à l’autre. S’il n’y avait pas l’un de ces deux pendants, cela ne serait pas moi. Ma plus grande fierté, c’est donc d’avoir réussi à mener de front les deux. J’ai toujours eu du mal à exprimer par les mots cette pensée mais quand on me disait que c’était impossible, je me disais que c’était impossible pour celui qui m’en parlait mais pas pour moi. Plus qu’une fierté, ma plus grande satisfaction c’est de pouvoir mener à terme les plus grands projets de ma vie malgré le handicap : d’abord le sport de haut niveau, maintenant le journalisme. Au final, j’ai réussi à m’ouvrir des portes que peu de collègues avaient réussi à s’ouvrir avant moi.
Entretien réalisé par Romain Cauliez et Mathieu Vigour dans les locaux de l’AS.