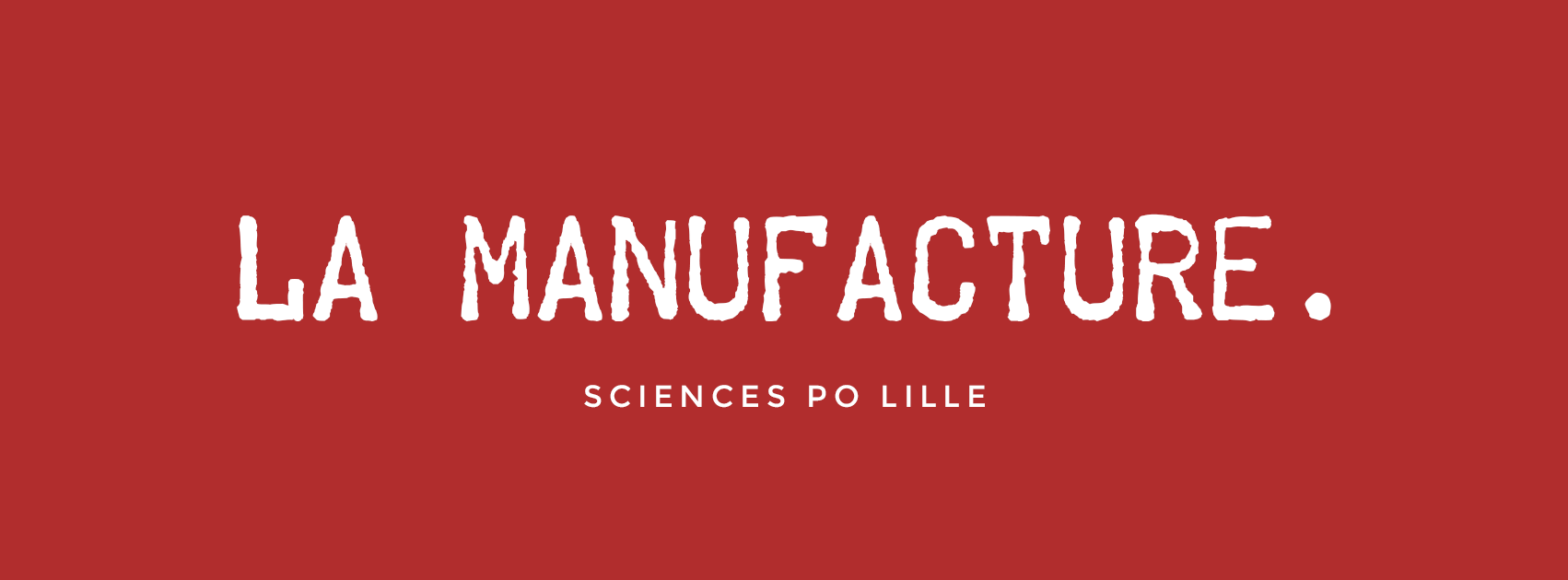Triste anniversaire. En novembre dernier, la Syrie célébrait les cinquante ans de l’ère Assad. Le 13 novembre 1970, Hafez el-Assad, membre du Parti Baas, jeune officier de l’armée de l’air, s’empare du pouvoir syrien suite à un coup d’Etat et règne jusqu’à sa mort. Cinquante ans plus tard, la famille Assad dirige toujours le pays. Un pays en ruines, morcelé, ravagé et qui a remplacé de force la Syrie éternelle. La Syrie de 2011 et des années qui suivent est rythmée par la guerre et le fracas quasi incessant des bombes. Les civils sont les premières victimes de plus de neuf années de guerre civile, qui se poursuit en sourdine et dans l’indifférence générale.
“Dégage”
La révolution syrienne naît un soir de la fin février 2011 à Deraa, petit bourg agricole à l’extrême sud du pays, lorsque des jeunes de 16 ans peignent sur les murs d’une école du quartier Arba’ine : « Ach-chaab yourid isqât al-nizâm » (« Le peuple veut la chute du régime »), « Erhal » (« Dégage »), « Jay alek el ddor ya doctor » (« Ton heure arrive docteur »). « Docteur » ou Bachar el-Assad, devenu président en 2000 mais ophtalmologue de formation. « Bachir », « Issa », « Naief Abazid » : chacun des graffitis hostiles au régime est courageusement signé.
Des tags symboliques mais dérisoires par rapport aux souffrances endurées par le peuple syrien à bout de souffle après quatre décennies de dictature sécuritaire du clan alaouite el-Assad. Suite aux arrestations d’une vingtaine d’enfants, des manifestations pacifiques ont lieu. La réponse immédiate du régime : violence, enlèvements, tortures. Une répression aidée par l’armée. En mars, le « printemps arabe », son vent de liberté et sa fièvre contestataire s’emparent définitivement des villes de Deraa, Damas, Homs et Banias pour s’étendre ensuite au reste du pays. Depuis, le visage de la Syrie a complètement changé. Il est meurtri et marqué au fer rouge de près de dix ans de conflit interminable dont les civils paient le plus lourd tribut.

Des villes devenues tombeaux de l’humanité
Ce qui a commencé comme une rébellion légitime contre un dictateur, après des années de peur et de soumission, s’est très vite transformé en champ de ruines. Certaines villes ont subi le conflit de plein fouet, imprégnant dès lors les mémoires collectives. Elles ont concentré l’acharnement de l’alliance militaire syro-russe volontiers soutenue par l’Iran qui, depuis début 2013, arme ouvertement le régime. Au nom de la dignité et de la justice, abritant un peuple en quête de liberté, certains territoires se sont révoltés. Deraa, là où tout a commencé en 2011, a ainsi été surnommée « berceau de la révolution ». Si son étincelle révolutionnaire a été éphémère, elle s’est entièrement éteinte en août 2018, mois durant lequel la ville fut reprise par le régime. Homs, « capitale de la révolution », troisième ville syrienne derrière Damas et Alep, s’est rapidement jointe au mouvement de révolte. Ces villes qui ont porté l’insurrection syrienne ont été rasées et leurs revendications bafouées, passées sous silence.
Pour Jomana Qaddour, née à Homs, co-fondatrice de l’organisation humanitaire Syria Relief & Development et à la tête du portefeuille de la Syrie au think tank américain Atlantic Council : « la chute d’Alep en 2016 a probablement été la plus difficile à observer puisqu’il s’agissait d’un siège qui a duré des années dans la plus grande ville de Syrie ». Elle poursuit : « L’évacuation a été massive et de nombreuses entités et pays ont été impliqués dans le déplacement massif de personnes d’Alep vers Idlib ». Alep, principal fief de la rébellion, a été amputée, dévastée ne devenant plus qu’un cimetière déserté. Qaddour qualifie la chute de la ville de « déchirante », sans oublier de rappeler que d’autres déplacements massifs ont eu lieu depuis. Et à mesure que les combats s’intensifient, de nombreux Syriens et Syriennes prennent le chemin de l’exil. C’est le cas de plus d’onze millions d’entre eux et elles à ce jour.

Depuis 2011, près d’un million de personnes se sont réfugiées dans le gouvernorat d’Idlib, près de la frontière turque, pour fuir les affrontements qui ont lieu dans d’autres régions du pays (1). Selon un rapport de l’Observatoire des camps de réfugiés datant de mai 2020, « sur les 4,1 millions de personnes vivant dans le nord-ouest de la Syrie, 2,7 millions sont des déplacés internes et 1,4 millions vivent dans des camps et des installations pour personnes déplacées » (2). L’intensification des bombardements en 2019 a largement contribué à accroître le nombre de déplacés de sorte que la capacité initiale des camps est devenue insuffisante. Samer Daboul, photojournaliste indépendant syrien, s’est rendu à plusieurs reprises dans ces camps de fortune surpeuplés. Muni de sa meilleure arme, son appareil photo, sillonnant des routes souvent boueuses, il a pu capturer l’intérieur de ce qu’il nomme froidement « colonies informelles », tout en dénonçant l’inhumanité de ces lieux. Puisqu’ici, selon ses mots, « rien ne s’apparente à un chez soi, ce ne sont même pas des tentes et encore moins des abris qui ressemblent à des maisons ».
Viol du droit international humanitaire
Dès lors que l’on parle d’attaques aveugles qui tuent des centaines de milliers de personnes et qui forcent le reste de la population à s’exiler, la situation des droits humains primaires pose légitimement question. Dans la plupart des villes comme Alep, Idlib ou Damas, les civils sont continuellement pris pour cibles. Celles-ci se sont transformées en champs de bataille. Fréquemment nommées « tombeaux de l’ONU », le droit y est complètement mort et les droits humains avec. Le ciblage de la vie civile est constant lorsque chacune des attaques successives touche gravement les infrastructures publiques : hôpitaux, écoles, marchés… La plupart des bombardements et explosions adviennent effectivement dans des zones peuplées sans objectifs militaires apparents.
Certains événements entraînent des séquelles à vie sur la population civile. La guerre brise des destins. Muhammad Najem, âgé de 18 ans et né dans la Ghouta orientale, plaine agricole à l’est de Damas et région résistante au pouvoir central, commence à relayer les atrocités de la guerre à l’âge de 15 ans, en se filmant avec son téléphone. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter en 2018 (3), il accuse frontalement les dirigeants syrien et russe, Bachar el-Assad et Poutine, et l’ayatollah iranien Khamenei de tuer son enfance. Lui qui rêvait de devenir joueur de football professionnel, les bombes ont précipitamment emporté tous ses rêves : « il n’y avait pas d’école, aucun endroit sûr pour jouer ou même pratiquer un sport ». Une expérience qui l’a marqué de façon permanente reste l’attaque chimique de la Ghouta orientale tenue par l’Armée syrienne libre et que le régime veut reprendre, en août 2013. Selon lui, « les gens connaissent les souffrances inimaginables que les victimes ont endurées en mourant, mais ils doivent aussi savoir que beaucoup de personnes dans la région souffrent encore de cette expérience. Sur les plans émotionnel et physique, nous avons des cicatrices à vie ».

En 2013, la Ghouta orientale est la première région à subir une attaque à grande échelle à l’arme chimique. Elle sert alors de « laboratoire » grandeur nature au régime pour l’emploi d’agents neurotoxiques. Damas dément l’utilisation d’armes chimiques. Mais des prélèvements permettront de certifier la présence de gaz moutarde et du sarin sur place, confirmée par des enquêteurs de l’ONU. En août de cette même année, le régime tire à l’arme incendiaire sur une école à Urum-al-Kabra. Pourtant, certaines substances sont interdites par la convention internationale bannissant le stockage, la production et l’usage d’armes chimiques (CIAC). Un rapport de Human Rights Watch publié en novembre dernier (4) montre ainsi les limites du droit international quant à la régulation des armes incendiaires qui provoquent des blessures immédiates et des souffrances permanentes pour les victimes survivantes. A ce titre, Muhammad Najem confie que, lors de l’attaque du 21 août 2013 dans les faubourgs de Damas, ses poumons ont été touchés. Il ajoute : « Je souffre d’un grave problème d’asthme qui m’envoie parfois à l’hôpital pour y être soigné. Je ne suis pas seul dans cette situation. Notre corps nous rappellera toujours les horreurs que nous avons vécues ».
« La Syrie, la liberté et rien d’autre »
Ce qui ressort alors des différents témoignages, à les écouter, fait étrangement écho à des slogans scandés à Nabek ou Baba Amr, lors des premières protestations qui agitent le pays en 2011 : « Dieu, la Syrie, la liberté et rien d’autre », « Liberté ! Liberté ! ». Parce qu’au fond, ce que souhaitent les Syriens et Syriennes n’a pas foncièrement changé depuis 2011. La quête de liberté, de droits et de dignité reste intacte. La volonté de paix occupe tous les esprits.
De son côté, Samer Daboul continuera coûte que coûte d’attendre les couchers de soleil pour les photographier, « en espérant chaque jour que ce ne soit pas le dernier et que le soleil se lèvera encore ». Quant à Muhammad Najem, il espère « la paix et la liberté », conjuguées à « une forme de démocratie pour que le peuple puisse choisir qui doit le diriger ». Il conclut : « J’espère qu’il restera suffisamment de survivants pour reconstruire un jour notre beau pays, et pour que les enfants de Syrie aient une vie normale – le jeu, l’école, la paix ». Evidemment, tous deux s’accordent dans l’espoir d’une « vie sans Assad ».
Il y a également la volonté que le monde ne soit plus spectateur de la guerre en Syrie puisque selon Najem, « personne ne parle assez de la Syrie. Les gens sont engourdis par les horreurs maintenant. Le monde ferme les yeux sur le génocide continu du peuple syrien pourtant nos messages ne doivent pas être ignorés, il y a tant de souffrance ». Lorsqu’il rapporte les derniers événements qui bousculent la Syrie, il raconte qu’Idlib continue d’être bombardée tous les jours, même dans les soi-disant « zones de désescalade » et regrette que « les gouvernements étrangers et les journalistes ignorent pour la plupart ces attaques contre les civils ».
Le dixième anniversaire du soulèvement pacifique syrien, en mars prochain, sera probablement une nouvelle fois un anniversaire de guerre, avec un régime qui applique la stratégie de la destruction pour survivre. Si les destructions sont au cœur des conflits armés, en Syrie, leur nature, leur étendue et leurs répercussions ne permettent pas de les considérer comme de seuls incidents inéluctables et fatidiques de l’affrontement. Et sans oublier de prendre en compte les atrocités que vivent les Syriens et Syriennes, il faut néanmoins se garder de les considérer comme « un ensemble indifférencié de victimes de la violence d’un régime criminel d’un côté, de la barbarie jihadiste de l’autre » (5). Car loin d’être des sujets passifs, eux et elles aussi sont dotés d’une réelle « capacité d’agir ». Depuis 2011, « ils font preuve d’une inventivité et d’une imagination extraordinaires, tant pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne que dans le déploiement de multiples formes d’expression culturelles, pour raconter ce qu’ils vivent, dire leurs espoirs, résister moralement à la tragédie, et ouvrir des voies vers un nouvel avenir ».
Hana Maayoufi
Sources :
- https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/idlib-vers-une-catastrophe-humanitaire
- https://www.o-cr.org/wp-content/uploads/2020/10/Idlib-Syrie-2.pdf
- https://twitter.com/muhammadnajem20/status/952897447180808192
- « ‘They Burn Through Everything’: The Human Cost of Incendiary Weapons and the Limits of International Law »
- Elisabeth Longuenesse et Laura Ruiz de Elvira dans “La société syrienne, entre résilience et fragmentation”, Confluences Méditerranée (04/2016), n°99