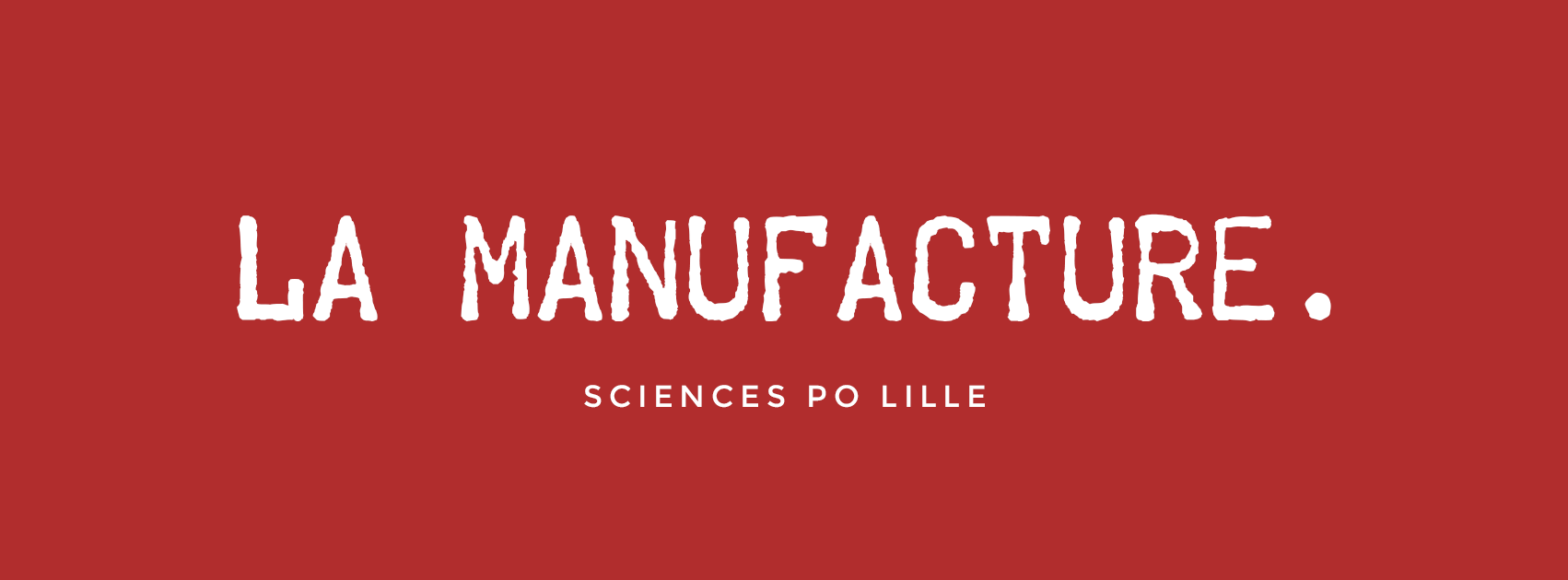La débâcle de l’État afghan et la victoire-éclair des talibans au moment du retrait des forces américaines, en août 2021, illustrent les vicissitudes d’une certaine politique étrangère. Les prémices de celle-ci surviennent à la fin des années 1990. À cette époque, les républicains sont devenus majoritaires au Congrès, lors du second mandat présidentiel de Bill Clinton. Cette politique étrangère est mise en œuvre par George W. Bush, lors de son premier mandat, suite aux attaques du 11-septembre, qui sont l’élément-déclencheur. Mais la forme qu’elle a prise, très particulière, a des fondements variés.
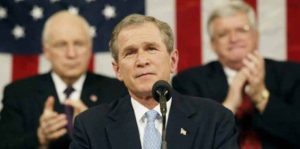
Décideurs néoconservateurs et fondements culturels
D’une part, si la réponse des États-Unis au 11-septembre s’est traduite par une intervention militaire en Afghanistan, ce format a été permis, entre autres, par la nature du cercle décisionnel du président Bush, marqué par un conformisme, et une forte place accordée à l’idéologie (la lutte contre un « axe du mal »). Les néoconservateurs de son Administration jouissent d’une influence non-négligeable : le secrétaire d’État Colin Powell, la conseillère à la sécurité nationale, Condoleezza Rice, mais surtout le vice-président Dick Cheney, et le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, bénéficient de l’oreille du président. Il se serait agi de refaçonner un « Grand Moyen-Orient », selon leurs vues, dans l’idée supposée de faire en Afghanistan (et en Irak) ce qui avait été fait en Europe après la Seconde Guerre mondiale. La « pensée groupale » caractérise la manière dont les décisions de politique étrangère sont prises à cette époque. Le cercle de décideurs, resserré autour du président Bush, est peu perméable aux opinions ou aux informations qui vont en contradiction avec ses propres convictions. Le groupe est convaincu de la moralité, de la justesse de ses décisions. L’information, les renseignements, sont manipulés afin de conforter ses propres idéaux (1), comme cela s’est vu au moment où les États-Unis préparaient la guerre en Irak, en 2003 (les « armes de destruction massive » qui pour ainsi dire, n’existaient pas).
En 2002, alors que l’offensive en Afghanistan est lancée, cette politique se voit attribuer par Pierre Hassner le qualificatif de « wilsonisme botté » (2). Le wilsonisme renvoie à l’une des quatre grandes traditions historiques de la politique étrangère américaine, identifiées par Walter Russell Mead, avec les jacksoniens, les hamiltoniens et les jeffersoniens (3). C’est un internationalisme. Il vise à l’exportation de la démocratie et de ses valeurs, des droits humains, mais en respectant la souveraineté étatique et en favorisant une coopération. Le fait qu’il soit botté prend toute son importance car il en modifie substantiellement le sens. Cela renvoie aux méthodes employées : c’est la « manière forte », le recours à l’outil militaire est un moyen privilégié, par rapport à d’autres, de la politique étrangère de Bush. Les grands principes universels servent à justifier une politique musclée d’exportation du modèle américain, sans concessions (4). Les institutions internationales (Nations unies, droit international notamment) et la diplomatie, sont vues comme une forme de compromission inadmissible avec l’ennemi. Elles font l’objet d’une défiance. C’est donc un idéalisme conservateur, intransigeant, qui ne reconnaît ni la diversité des expériences démocratiques, ni le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (Louis Balthazar).
D’autre part, une telle tendance repose sur des fondements culturels. Le « style national » américain, décrit par Stanley Hoffman (5), se base sur une vision grandiose de l’expérience historique et de la nation américaines. Elles sont vues comme uniques au monde, dans un sens approbateur : c’est l’exceptionnalisme américain. Cet exceptionnalisme constitue le fondement moral de l’action internationale des États-Unis, comme le souligne Gilles Vandal (6). Ainsi, les États-Unis sont une « puissance bienveillante », et « ce qui est bon pour les États-Unis l’est aussi pour le monde ». C’est ce qui explique l’attitude messianiste et l’idéalisme des États-Unis dans le monde. Ils ont donc pour « mission » de refaçonner le monde à leur image. Ces éléments font partie des traits caractéristiques de la relation des États-Unis avec le reste du monde, et se retrouvent accentués dans l’Administration néoconservatrice du président Bush. La politique étrangère menée par ce dernier, en Afghanistan (mais également en Irak) repose ainsi sur des postulats fondamentalement ethnocentriques, sur un manque de compréhension, de connaissance de l’histoire des peuples, ici celle du peuple afghan.
Les limites de la politique de « nation-building »
Certes, le pays a changé depuis l’intervention américaine. Les progrès de la scolarisation des filles, qui passe de 6 % au début des années 2000 à près de 40 % en 2017, sont une réalité. L’indice de développement humain est passé de 0,37 à 0,51 même s’il reste faible. L’espérance de vie à la naissance est passée de 56 ans en 2001 à presque 65 ans en 2019 (7). La situation économique est plus favorable (en tout cas, « moins mauvaise ») qu’au début des années 2000. Le produit intérieur brut a quant à lui été multiplié par 4 depuis 2002, même s’il reste peu élevé, avoisinant les 18-20 milliards de dollars. Néanmoins, l’abondante aide américaine n’a pas vraiment permis ces progrès au-delà des grandes villes afghanes (Kaboul, Hérat, Kandahar entre autres). Les inégalités sont criantes, et le pays, toujours majoritairement rural, reste l’un des plus pauvres du monde.
Par conséquent, la « greffe » de l’État occidental, construit « de gré, ou de force » par les États-Unis, n’a pas vraiment pris racine. L’ambition de construire une démocratie libérale, avec un État de droit, similaire à ceux que l’on trouve en Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord, peut se retrouver confrontée à plusieurs conditions structurelles. Ces conditions transcendent la volonté des acteurs : l’expérience historique, l’héritage institutionnel, la géographie, la culture politique, le développement économique, la division ethnique. Si certains de ces éléments évoluent, ce changement se fait sur un horizon temporel s’étirant sur des décennies, voire des siècles, dépassant de loin celui des individus.
À titre de comparaison, lorsque les Américains ont voulu reconstruire une démocratie en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un important héritage institutionnel subsistait, issu notamment d’une longue expérience nationale s’achevant par la naissance d’un État édifié par Otto von Bismarck, et de l’expérience démocratique de Weimar dans l’entre-deux guerres. De même, un modèle démocratique comme celui de la France, avec un État de droit, unitaire et centralisé, et tout ce que cela implique dans le rapport à l’État, comme pratiques et comme mœurs, n’est pas apparu en une vingtaine d’années, mais a pris plusieurs siècles avant d’émerger sous sa forme actuelle. La « culture de l’État » à l’occidental, implique d’importantes conditions structurelles. La démocratie suppose une culture politique particulière, fruit d’un long apprentissage, décrit par Alain Garrigou dans Le vote et la vertu. Il faut attendre la fin du XIXe siècle en France et la IIIe République pour voir partiellement aboutir ce processus. De telles structures politiques ont donc peu de chances de s’établir de manière pérenne sur la base de la volonté d’un acteur venu de l’étranger et qui cherche à y implanter son modèle en quelques années.
Chacun à leur manière, les apports sociohistoriques de Max Weber dans Économie et société (1921), et de Norbert Elias dans La Dynamique de l’Occident (1975), l’ont montré. Par exemple, les deux modèles politiques occidentaux qui viennent d’être évoqués, reposent sur la domination d’une autorité ou d’une administration impersonnelle, de type légale-rationnelle, qui puise sa légitimité dans la rationalité : la loyauté est envers une institution abstraite qui trouve son fondement dans des lois générales. De plus, des siècles peuvent être nécessaires pour voir émerger une centralisation des fonctions de police par un seul acteur, qui est l’État, parallèlement à une pacification de la société. Pour que l’État dispose du monopole de la contrainte physique légitime, permis par l’existence d’une force armée à son service, un ancrage profond, qui s’étend sur une longue période, est essentiel. Fondamentalement, dans la plupart des pays d’Europe ou d’Amérique du Nord, c’est pour ces raisons que la police et l’armée, les fonctionnaires ou l’administration de manière générale, ne changent pas de loyauté lorsque le pouvoir politique change de mains : elles servent l’État, incarné par des institutions (une présidence de la République, un chef de gouvernement…) ; elles ne sont pas supposées être au service d’une personne privée ou affiliées à un parti politique.
Or, l’Afghanistan semble répondre à des logiques totalement différentes. Ce ne sont pas l’appartenance nationale, l’existence d’une autorité légale-rationnelle, le rapport à un État ou à un pays qui sont déterminants, mais plutôt les appartenances tribales, claniques, religieuses, ethniques, qui bien davantage peuvent conditionner la loyauté. La corruption étendue, et le fait que ce gouvernement n’ai jamais acquis la légitimité auprès de sa population, peuvent être ainsi expliquées. L’État afghan qui a connu une déroute en 2021 était surtout soutenu par des Ouzbeks et des Tadjiks, tandis que la mouvance talibane est pachtoune. Cette tendance ethnocentrique des États-Unis (et de certains pays occidentaux) à lire la réalité des autres pays au travers de leurs propres cadres interprétatifs – l’État nation, l’individualisme et la citoyenneté démocratique, des concepts proprement occidentaux – explique certains de leurs déboires de politique étrangère, à l’instar du Vietnam, ou de l’Irak (8). C’est sur ces conditions structurelles que toute la pratique du « nation-building » a trébuché. Sans doute s’agit-il d’une autre raison, liée aux dimensions culturelles et idéologiques de la politique étrangère des États-Unis, pouvant expliquer la chute de l’État afghan et le retour des talibans à Kaboul en août 2021.
Hugo Louveau.
________________
(1) Charles-Philippe David, La politique étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation. Presses de Sciences Po, 2015, 648 p., qui est un incontournable, mais voir aussi Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche. De Truman à Obama : la formulation (imprévisible) de la politique étrangère des États-Unis. Presses de Sciences Po, 2015, 1184 p.
(2) Pierre Hassner, « L’empire de la force ou la force de l’empire ? », Cahiers de Chaillot, n°54, 2002, p. 43.
(3) Walter Russel Mead, Sous le signe de la providence : comment la diplomatie américaine a changé le monde, Odile Jacob, 2003, 398 p.
(4) Louis Balthazar, « Chapitre 3 / Le cadre culturel le style national », dans : Charles-Philippe David, La politique étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation. Paris, Presses de Sciences Po, « Références », 2015, pp. 107-146.
(5) Stanley Hoffmann, Gulliver empêtré : Essai sur la politique étrangère des États Unis, Paris, Seuil, 1971, cité inBalthazar Louis, « Chapitre 3 / Le cadre culturel le style national », dans : Charles-Philippe David, La politique étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation. Paris, Presses de Sciences Po, « Références », 2015, pp. 107-146.
(6) Gilles Vandal, « Chapitre 2. L’exceptionnalisme comme fondement moral », dans Charles-Philippe David, et Frédéric Gagnon, Théories de la politique étrangère américaine : Auteurs, concepts et approches., Presses de l’Université de Montréal, 584 p., pp. 109-158.
(7) Brice Le Borgne « Pauvreté, scolarisation, opium… Découvrez à quel point l’Afghanistan a changé ces vingt dernières années », Franceinfo (en ligne, consulté le 7 septembre 2021 via : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/infographies-pauvrete-scolarisation-opium-decouvrez-a-quel-point-l-afghanistan-a-change-ces-vingt-dernieres-annees_4742327.html)
(8) Brice Couturier, « Quand les logiques tribales l’emportent sur les logiques nationales », Le Tour du monde des idées, France Culture (en ligne, consulté le 7 septembre 2021 via : https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/quand-les-logiques-tribales-lemportent-sur-les-logiques-nationales).