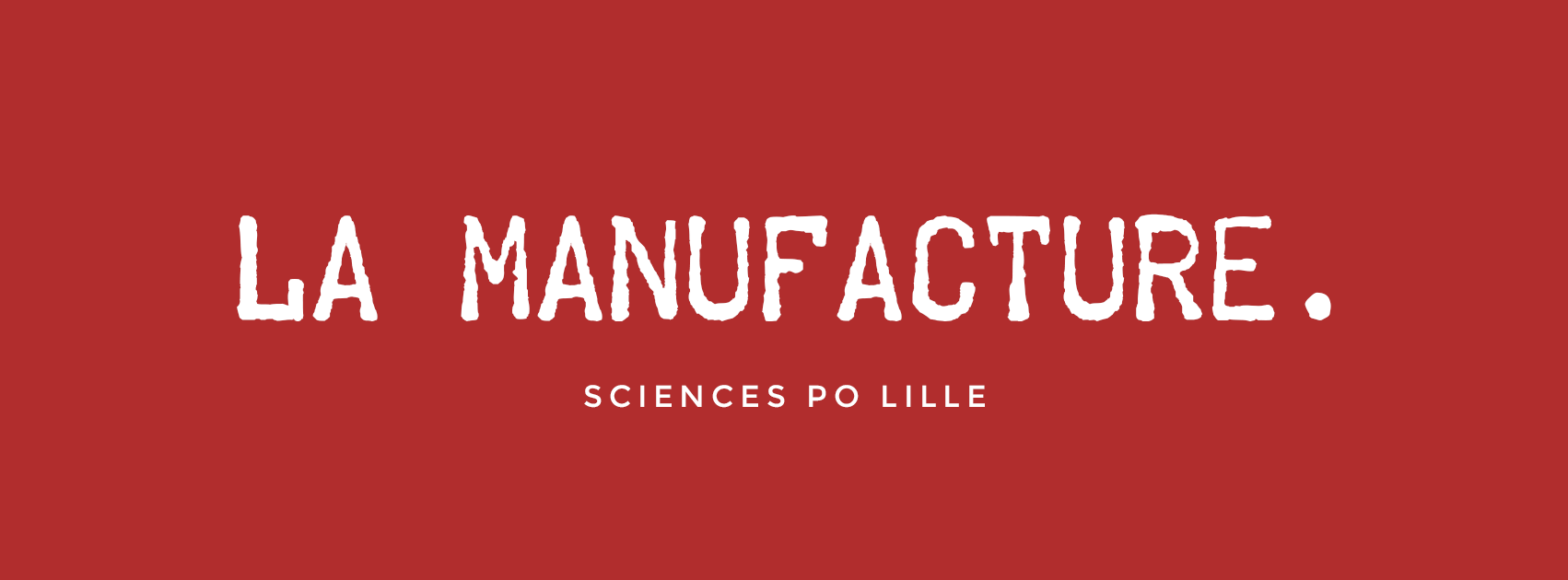La tragédie afghane est une réalité en matière de droits humains. Il n’en reste pas moins que le retrait des États-Unis d’Afghanistan s’inscrit avec une certaine cohérence dans une tendance plus large de la politique étrangère américaine.
Une continuité avec la politique étrangère de Barack Obama
Des éléments viennent contredire la thèse d’une « erreur décisionnelle », de l’Administration Biden. L’idée-même d’une rupture au sein de la politique étrangère américaine, induite par ce retrait et ses conséquences, est à nuancer. À vrai dire, les décideurs actuels de la politique étrangère des États-Unis sont tous expérimentés en la matière. Qu’il s’agisse d’Antony Blinken, secrétaire d’État, de Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale, ou encore d’Avril Haines, directrice nationale du renseignement, pour ne citer qu’eux ; tous se sont illustrés lorsqu’ils ont servi le président Barack Obama. Biden a lui-même été membre, puis à plusieurs reprises président de la Commission du Sénat sur les relations extérieures, et vice-président des États-Unis entre 2009 et 2017. C’est le président américain le plus expérimenté dans le domaine des affaires extérieures depuis la présidence de George Bush père (1989-1993), qui avait été directeur de la CIA, et vice-président du président Reagan (1981-1989).

L’Administration Biden, qui met en œuvre en 2021 le retrait américain d’Afghanistan, est donc composée d’un groupe de décideurs expérimentés, sensiblement les mêmes que ceux de la présidence d’Obama. Afin de mieux cerner pourquoi Biden a agi ainsi, il semble pertinent de revenir sur ce qu’avait été la politique étrangère de Barack Obama. Ce sont ces mêmes personnes qui ont mené les négociations avec l’Iran ; qui ont bombardé des terroristes en utilisant des drones. Surtout, ce sont ces individus qui ont supervisé une opération des forces spéciales de l’US Navy à Abbottabad au Pakistan, avec pour conséquence l’exécution de Ben Laden, en 2011. Enfin, c’est en grande partie ce personnel qui participe à la décision emblématique du retrait des États-Unis d’Irak en 2011.
En dépit des apparences, de ses discours, de son respect des institutions internationales et du multilatéralisme, la politique d’Obama paraît peu internationaliste, pas très idéaliste, peu encline à s’engager de manière déterminée dans la défense de valeurs universelles (comme les droits humains). Obama est plutôt un décideur « prudent, pragmatique et réaliste », selon le professeur Charles-Philippe David, spécialiste de la politique étrangère américaine (1). En mai 2014, Obama déclare : « Depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines de nos erreurs les plus coûteuses sont venues non pas de notre retenue, mais de notre disposition à nous précipiter dans des aventures militaires sans réfléchir à toutes les conséquences – sans mobiliser un appui international et établir la légitimité de notre action ». Obama est parfois décrit comme un « réaliste idéaliste », un « réaliste libéral », ou un « pragmatiste progressiste ». Au regard des évolutions récentes, il ne semble pas en être autrement de Joe Biden, qui assume jusqu’au bout le désengagement américain d’Afghanistan après la chute de Kaboul (16 août 2021) : « Notre mission en Afghanistan n’a jamais été supposée être la construction d’une nation. Elle n’était pas censée créer une démocratie unifiée et centralisée […]. Je soutiens depuis de nombreuses années que notre mission doit se limiter à la lutte contre le terrorisme ». Biden s’inscrirait ainsi dans une démarche similaire à celle d’Obama, par une politique empreinte de pragmatisme et de réalisme.
Il s’agit de préserver le leadership américain, par des engagements volontairement limités, réfléchis, et de laisser la place à la coopération internationale et à la souveraineté des autres États. Pourtant, les conséquences du retrait américain en Afghanistan sont dramatiques, en termes de droits humains. Mais pour le président américain, il est possible que ces considérations universalistes n’entrent pas directement en jeu dans le cas présent : les États-Unis de Joe Biden semblent sur la voie du renoncement à exporter ces valeurs et à refaçonner le monde selon les idéaux américains. C’est bien au regard de la politique internationale d’Obama qu’il faut analyser celle du président actuel (en particulier ce choix), avec une politique étrangère qui se veut prudente, hésitante, presque « calculatrice » (C-P. David).
Le retrait d’Afghanistan, entre objectifs opérationnels et contraintes de politique intérieure
Par ailleurs, la politique intérieure peut permettre d’expliquer que les États-Unis aient décidé de ne pas se maintenir en Afghanistan. Le président Biden le rappelle régulièrement : quand les États-Unis y sont intervenus en 2001, le but premier était de s’attaquer à Al Qaïda, ce qui a impliqué de renverser le régime taliban, qui avait refusé de livrer Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001, préparés et planifiés sur le sol afghan. Depuis, Al Qaïda a reculé, et Ben Laden a été exécuté. D’un certain point de vue, l’objectif premier des États-Unis a donc été rempli. En tout cas, c’est ce qui transparaît dans le discours du président Biden, le 31 août 2021, qui n’a de cesse de rappeler pourquoi les États-Unis se sont engagés en Afghanistan : pourchasser Al Qaïda. Le président met ainsi fin à une guerre longue de vingt années.
À l’instar de la Guerre du Vietnam et de la guerre en Irak, celle d’Afghanistan est devenue impopulaire au fur et à mesure qu’elle s’enlisait. Or, l’opinion publique américaine est bien plus encline à soutenir les interventions rapides et décisives, à l’image de la guerre du Golfe en 1991, que les opérations longues dont l’issue est indéterminée. La décision de mener le retrait jusqu’à son terme, bien qu’elle ait été en grande partie imposée par son prédécesseur, semble donc cohérente : la guerre risquait de devenir difficile à justifier. Pour Biden, il s’est agi d’ « arrêter les frais », en entérinant en quelque sorte l’échec des États-Unis : « C’est aux Afghans de décider quel gouvernement ils veulent » (8 juillet 2021). Un mois plus tard, suite à la chute de Kaboul, il défend son choix : « Les troupes américaines ne peuvent et ne doivent pas se battre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas prêtes à mener elles-mêmes » (16 août 2021). Si les images désastreuses du retrait peuvent, à court terme, constituer une sérieuse atteinte à la crédibilité du président dans l’opinion, c’est probablement moins le cas à moyen terme.
Autrement dit, pour le président, il est temps de régler cet épineux problème : finir une guerre qu’il n’a pas lancée, et qu’il se retrouve à devoir gérer, et faire rentrer les Boys aux États-Unis. Là encore, la proximité avec la politique étrangère de Barack Obama mérite d’être soulignée, bien que Biden aille plus loin, puisqu’il fait ce qu’Obama ne s’était pas résolu à faire.
La poursuite d’une dynamique pour la superpuissance américaine
Enfin, il faut s’intéresser de manière plus large à la superpuissance américaine pour mieux saisir ce que ce retrait implique. Depuis la fin de la guerre froide et du monde bipolaire, les États-Unis ont été décrits comme un hégémon, une puissance qui dirigerait le monde par consensus, selon Michael Cox (2). Cet hégémon aurait connu une « tentation impériale ». Cette tendance atteint son apogée lors du premier mandat de George W. Bush, marqué par une forte propension à l’interventionnisme armé en Irak et en Afghanistan, et la volonté de refaçonner la région selon les vues américaines. D’après certains auteurs de relations internationales, comme Robert Keohane, il y aurait désormais un « après-hégémonie » (3). Depuis les mandats de Barack Obama, la puissance américaine semble en train de se redéployer : une dynamique de retrait progressif de leurs engagements au Moyen-Orient, dans une optique de pivot vers l’Asie, a été enclenchée. Ainsi, les États-Unis ne sont pas intervenus contre le régime de Bachar el-Assad en 2013. Le retrait d’Irak a été mené à son terme en 2011.
La présidence de Donald Trump, dans son contenu, reflète un refus assumé et décomplexé d’assurer le rôle de superpuissance et de leader du monde occidental, avec une aversion pour les engagements internationaux contraignants (OTAN, accord sur le nucléaire iranien, accord de Paris de 2015). Avec le retrait d’Afghanistan, la présidence de Biden pourrait s’inscrire dans une logique semblable. Il s’agit désormais de privilégier le soutien aux alliés (surtout après le mandat de Donald Trump), le recours à la « puissance douce », évoqué par Joseph Nye (4), et une empreinte militaire à plus petite échelle. En cela, le retrait américain d’Afghanistan mené par Joe Biden s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de la superpuissance américaine, en continuité avec la doctrine de politique étrangère de Barack Obama, et que certains auteurs ont interprété comme le début d’une ère « post-hégémonique ».
En outre, le choix d’engagements plus prudents, plus mesurés et pragmatiques, après une phase de lourds engagements, n’est pas quelque chose d’inédit dans l’histoire de la politique étrangère des États-Unis. À bien des égards, les idées et les processus décisionnels qui ont conduit à la Guerre du Vietnam sont proches de ceux qui ont mené à celle en Afghanistan : l’illusion groupale, le rôle de l’idéologie (renforcé par le contexte de guerre froide), la volonté de refaçonner un espace géographique selon les idéaux américains, et un interventionnisme musclé. Après la victoire de Richard Nixon à l’élection présidentielle de 1968, les États-Unis optent pour un redéploiement de la puissance et la politique étrangère, œuvre de Henry Kissinger, opère un revirement remarquable : les États-Unis adoptent une position internationale plus réaliste et pragmatique, comme en témoignent le rapprochement avec la Chine en 1971 ; en 1973, les accords de Paris entament la vietnamisation du conflit vietnamien, et en avril 1975, la guerre prend fin.
En fin de compte, pour savoir si le retrait américain d’Afghanistan est un échec, il faudra observer la manière dont se déroulent les événements en Afghanistan. Les talibans utilisent une communication qui se veut rassurante, et semblent vouloir montrer un changement avec leur régime qui avait disparu en 2001. Certes, l’Afghanistan est différent d’il y a vingt ans, les changements qu’a connus le pays sont une réalité dont il faut tenir compte. Mais en même temps, les femmes sont en train d’être invisibilisées dans l’espace public à Kaboul, et peu d’informations permettent d’établir ce qu’il se passe en dehors de la capitale. Le nouveau ministre de l’intérieur afghan, réputé proche d’Al Qaïda, se trouve sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. C’est donc un régime répressif qui semble se mettre en place. Tout l’enjeu pour la superpuissance américaine est de savoir si l’Afghan redeviendra un sanctuaire du terrorisme international. Après tout, c’est pour cela qu’il y a vingt ans, les États-Unis étaient intervenus. Là alors se posera véritablement la question d’un échec américain.
Hugo Louveau
(1) Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche. De Truman à Obama : la formulation (imprévisible) de la politique étrangère des États-Unis. Presses de Sciences Po, 2015, 1184 p.
(2) Michael Cox, « The Empire’s Back in Town : Or America’s Imperial Temptation – Again », Millenium, vol. 32, n°1, 2003, cité in Charles-Philippe David et Julien Tourreille, « Chapitre 4. Les théories de l’hégémonie américaine », dans Frédéric Gagnon, et Charles-Philippe David, Théories de la politique étrangère américaine : Auteurs, concepts et approches., Presses de l’université de Montréal, 2018, 584 p., pp. 209-244.
(3) Robert Keohane, International Institutions and state Power : Essays in International Relations Theory, Boulder, Westview Press, 1989, cité in Charles-Philippe David et Julien Tourreille, op. cit.
(4) Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 1990.