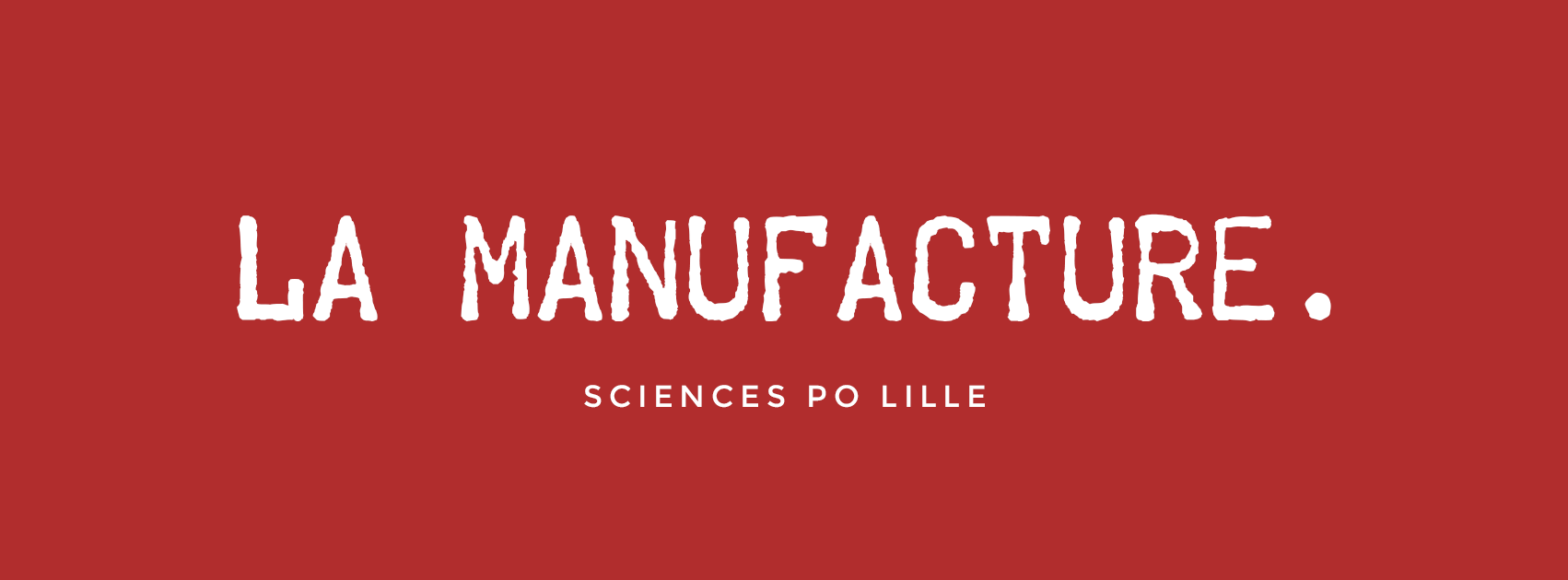Il paraît que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, et ce n’est pas Bienvenue à Suburbicon, sixième film de George Clooney et cinquième collaboration avec les frères Coen, qui va nous contredire, avec son esthétique impeccable et son ton à la fois léger et grinçant. Cette fois, cependant, la configuration du trio est innovante : c’est Clooney que l’on retrouve derrière la caméra.
D’un côté, on a une histoire imaginée par Joel et Ethan dans les années 90 sur une famille qui, sous des allures respectables, se révèle impliquée dans une affaire de meurtre et de fraude à l’assurance, et de l’autre, l’idée récente de Clooney de relater, avec le scénariste Grant Heslov, un fait divers américain des années 50 : l’installation et l’intimidation d’une famille afro-américaine dans une banlieue blanche.
Au final, les deux projets voient le jour sous forme d’un même scénario et d’un même film : Bienvenue à Suburbicon.
Ségrégation en terrain aseptisé
Le film commence comme une publicité d’adoucissant : une banlieue uniforme et aseptisée où les enfants jouent dans les rues, pas un brin d’herbe ne dépasse des plates-bandes. Le facteur fait sa tournée matinale, sa face ronde, étirée en un large sourire … se fige, quand il se rend compte que les nouveaux arrivants, les Myers, sont afro-américains.
Se déclenche alors insidieusement un harcèlement moral n’illustrant que trop bien la ségrégation raciale de l’époque : cela commence par des clôtures, puis on leur interdit l’accès à l’épicerie locale, et l’on se poste par centaines devant chez eux avec des tambours avant de leur jeter des pierres, comme pour rabattre une bête sauvage au fond des bois.
Ce pan du film se base sur un fait divers qui s’est déroulé dans les années 50 à Levittown, Pennsylvanie, une ville construite à la chaîne et de toutes pièces par l’entrepreneur Levitt & Sons, qui se voulait symbole de l’american way of life : une banlieue paisible, sans histoires … et 100% blanche.
Car William Levitt refuse de vendre ses maisons aux afro-américains, poursuivant la logique d’un programme de la FHA (Federal Housing Administration) des années 30, qui n’accordait des prêts aux promoteurs immobiliers que pour des quartiers excluant les familles noires, estimant que les lotissements mixtes perdaient de la valeur avec le temps.
Le problème, c’est que William et Daisy Myers parviennent à passer à travers les mailles du filet en rachetant la maison au couple précédent et non au promoteur. Dans les deux semaines suivant leur emménagement en 1957, les tentatives d’intimidation se multiplient et gagnent en intensité jusqu’à ce que la police parvienne à évacuer le siège installé devant leur maison. La famille continuera de recevoir des menaces pendant des mois, mais habitera à Levittown pendant quatre ans.
La persévérance du couple leur vaudra d’être érigés en héros de la lutte pour les droits civiques, et Daisy Myers, qui a écrit un livre sur les évènements, d’être baptisée « Rosa Parks du Nord ».
Damon à bicyclette
De l’autre côté de la rue, vit Gardner Lodge, père de famille neurasthénique, qui a commandité l’assassinat de sa femme pour pouvoir toucher l’assurance vie et finir ses jours aux Caraïbes avec sa belle-sœur, bien plus attirante.
On y retrouve l’essence même des histoires des frères Coen : une combine qui tourne mal, et une équipe de bras-cassés hauts en couleurs. Matt Damon s’extrait enfin de ses rôles habituels d’américain moyen propre sur lui, et porte à merveille les chemises à manches courtes maculées de sang et les clubmaster rafistolées avec du scotch – le point d’orgue de sa performance étant la scène où on le voit cacher un cadavre, puis reprendre sa route en pleine nuit sur une bicyclette d’enfant. Julianne Moore, quant à elle, excelle en ménagère névrosée. A noter également : le jeu jouissif d’Oscar Isaac en agent d’assurance (que Clooney aurait dû interpréter dans le scénario d’origine). Le tout permet de restituer ce qui fait la force des films « Coen » : une atmosphère déstabilisante, à la frontière entre l’humour et le sordide.
Une hybridation maîtrisée contre le racisme et l’aveuglement
On n’aurait su imaginer une hybridation scénaristique plus profitable que la collaboration Clooney-Coen. Les deux histoires, en effet, se corrigent et se complètent l’une l’autre. Celle de la famille Myers permet de donner plus de relief et d’originalité à ce qui aurait pu être un condensé vu et revu des frères Coen, qui avec leur fantaisie évitent de leur côté à Clooney un film trop moralisateur, qui gagne ainsi en finesse. D’ailleurs, Bienvenue à Suburbicon, moins « Coen » qu’Ave César ! ou Burn after Reading, peut s’avérer être un bon compromis pour découvrir en douceur la filmographie des deux frères.
En mettant l’histoire des deux familles sur le même plan, le film dénonce l’aveuglement et le cloisonnement d’une communauté, qui s’acharne sur une famille qui, elle, n’a rien fait à personne alors qu’un meurtrier adultère se trouve sur le trottoir d’en face, le seul témoin de l’horreur étant Nicky, le fils de Gardner, dont l’interprète évoque étrangement un jeune Alden Ehrenreich (Ave César !) par son visage à la fois candide et expressif.
Un pari réussi pour un Clooney qui confirme une nouvelle fois sa maîtrise de la caméra, what else ?
Bienvenue à Suburbicon, film américain sorti le 6 décembre, réalisé par George Clooney sur un scénario de Joel et Ethan Coen et Grant Heslov, avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac.
Joséphine Coadou
Bienvenue à Suburbicon appartient à Paramount Pictures et Metropolitan Filmexport. L’utilisation de très courts extraits du film rentre dans le cadre légal d’une utilisation dite équitable – ici, une utilisation à des fins de critiques.