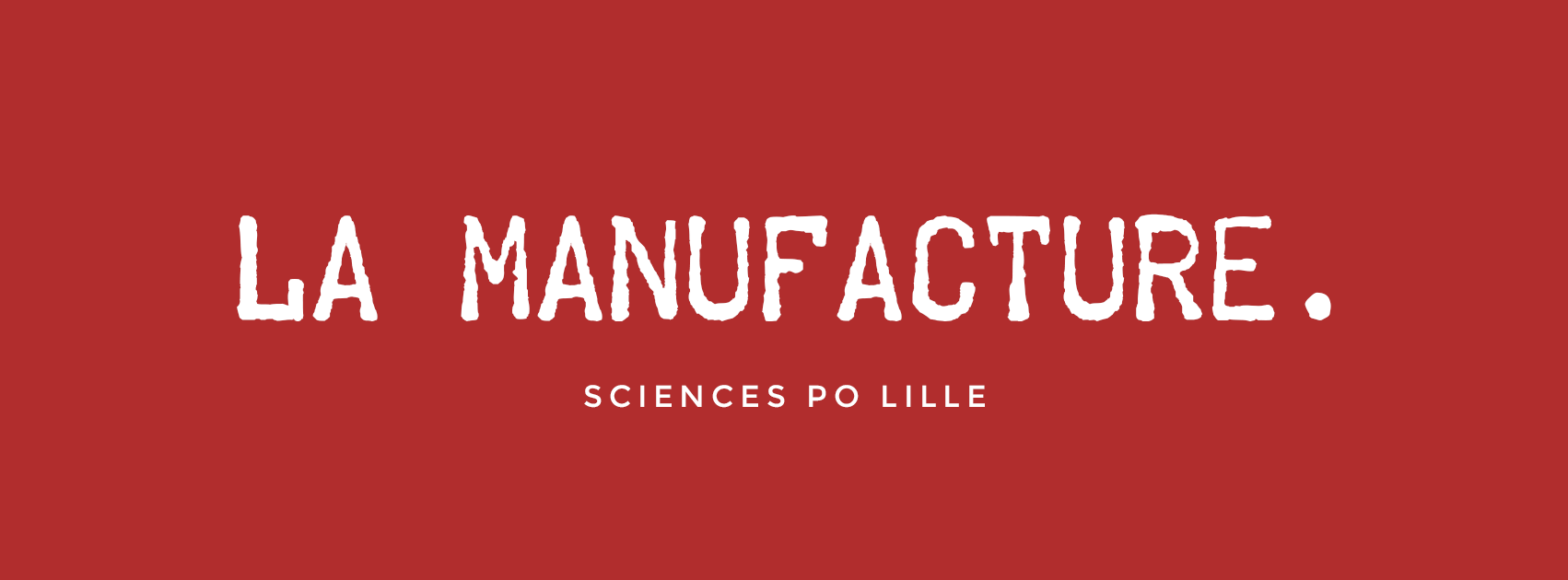L’Espagne fête ce mois-ci le quarantième anniversaire de sa Constitution dans un contexte politique agité. Dans quelques semaines, le conflit politique le plus important de sa jeune histoire sera soumis au jugement du Tribunal Suprême, la plus haute juridiction espagnole.
Les leaders politiques du procés seront jugés pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Le procés est le terme catalan qui désigne, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité en 2010 par le Tribunal Constitutionnel de certains articles du nouveau statut d’autonomie de la Catalogne, le processus par lequel la Généralité autonome de Catalogne, gouvernée par les nationalistes, a mis en œuvre à partir de 2012 un calendrier de déconnexion visant l’indépendance. Le procés a abouti à la promulgation de deux lois : la loi du 6 Septembre 2017 de convocation à un référendum d’autodétermination et la loi du 7 septembre 2017 dite de transition juridique de l’état de communauté autonome à état indépendant. Ces deux lois ont permis la tenue le 1er octobre 2017 d’un référendum d’auto-détermination qui a débouché sur une déclaration d’indépendance de la Catalogne le 27 octobre 2017. Tous ces actes étant frappés de nullité absolue et déclarés illégaux par le Secrétariat Juridique du Parlement de la Généralité et le Tribunal Constitutionnel, cela déboucha sur la mise en examen et détention provisoire des dirigeants catalans et la fuite à Bruxelles du Président de la Généralité, Carles Puigdemont.
Morcellement au sein du gouvernement
En novembre dernier, le Parlement national a été le théâtre d’un incident sans précédents. Lors d’une séance de questions au Gouvernement, le député nationaliste catalan Gabriel Rufian a traité le ministre des affaires étrangères socialiste et ancien président de la Commission Européenne, Josep Borrell, de militant fasciste. La tension est arrivée à son comble lorsque le ministre Borrell s’est plaint d’avoir reçu un crachat lancé par un des députés nationalistes passant devant le ministre alors qu’il suivait Gabriel Rufian, expulsé par la présidente du Parlement pour ses insultes répétées. Cette scène symbolise sans doute l’hystérie politique que traverse l’Espagne depuis plus d’un an.
Le 1er juin 2018, le gouvernement du PP (Parti Populaire, droite) présidé par Mariano Rajoy a été renversé après adoption d’une motion de censure et remplacé par un gouvernement présidé par Pedro Sanchez, secrétaire général du PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol). Du fait de sa grande fragilité, beaucoup de journalistes et d’analystes ont prédit un mandat de très courte durée : le PSOE ne disposait alors que de 85 députés. Cet exécutif a même été surnommé « gouvernement Frankenstein » par l’opposition en raison des soutiens très différents qu’a dû rassembler Pedro Sanchez afin de gouverner : nationalistes catalans de gauche (ERC), nationalistes catalans de droite (PDeCat), nationalistes basques de droite (PNV), nationalistes basques d’extrême-gauche (Bildu) et la formation d’extrême-gauche Podemos. Bien que contraint à gouverner avec un budget de droite hérité de Mariano Rajoy et sujet au chantage constant des multiples partis qui le menacent de retirer leur soutien, ce gouvernement résiste. Pedro Sanchez estime sûrement qu’il lui faut tenir le plus longtemps possible sous les projecteurs afin de donner à voir aux Espagnols ce qu’il pourrait faire s’il disposait d’une majorité suffisante, plutôt que de convoquer de nouvelles élections. Le PP, affaibli par l’apoplexie idéologique et la corruption des années Rajoy, a renouvelé ses dirigeants en même temps que son discours. Pour ne pas perdre le vote de la droite traditionnelle et conservatrice, et en concurrence féroce avec Ciudadanos (centre-droit), son nouveau président Pablo Casado radicalise son propos sur le problème catalan et excite les pulsions centralisatrices nationalistes « espagnolistes » en réaction au nationalisme catalan. Ciudadanos continue sur la lancée en adoptant une posture d’alternative européiste et libérale au bipartisme espagnol classique entre le PP et le PSOE. Ce jeune parti catalan, né en 2006 comme réelle force d’opposition au nationalisme au sein du Parlement régional, tient sa légitimité de son combat de longue date contre les séparatismes, terrain laissé vacant par un bipartisme trop occupé à monnayer le soutien parlementaire des nationalistes à coup de concessions fiscales et délégations de compétence. Il séduit autant l’électorat de droite lassé de l’inaction du PP en défense du constitutionnalisme que les électeurs de gauche déçus de la complaisance affichée de l’antenne catalane du PSOE, le PSC (Parti Socialiste Catalan) envers les nationalistes en Catalogne. Quant à Podemos, la formation d’extrême-gauche, persiste dans son discours antisystème et entretient de bonnes relations avec les nationalismes, de droite comme de gauche au prix d’ambigüités troublantes quant à son soutien au maintien de l’intégrité territoriale espagnole.
La décrédibilisation des institutions
A ce moment de particulière fragmentation politique de l’Espagne, les institutions subissent une crise de légitimité. Tout d’abord, et bien que l’Espagne soit classée comme une « démocratie parfaite » dans le baromètre de The Economist, les nationalismes -catalan et basque- continuent à promouvoir, autant nationalement qu’internationalement, l’image d’une Espagne aux relents fascistes. Sur ce point, ils sont rejoints par la critique antisystème de Podemos, fort de son succès électoral à la suite des dégâts causés par la crise économique de 2008, dont les conséquences ont été dévastatrices et sont toujours visibles en Espagne.Mais la menace qui pèse le plus sur ces institutions est interne : ces dernières semaines, les acteurs des institutions démocratiques espagnoles eux-mêmes ont fortement ont participé à leur décrédibilisation.
Fin octobre, le Tribunal Suprême espagnol s’est décrédibilisé en opérant un revirement de jurisprudence en l’espace de deux semaines. Lors d’une première séance, les juges ont rendu un arrêt historique en décrétant que les banques devraient désormais payer l’impôt sur les hypothèques à la place des clients. Deux semaines plus tard, face à l’affolement des milieux financiers, une deuxième séance plènière a été convoquée. Lors d’un vote divisé, l’autorité judiciaire la plus importante d’Espagne s’est contredite, inversant son jugement. Ainsi, les juges se sont attiré les critiques d’une très grande majorité de citoyens qui ont perçu cette décision comme une capitulation de la plus haute instance du pouvoir judiciaire face aux milieux financiers.
Le second abus a eu lieu le 19 novembre, au moment de la nomination des membres du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. Cet organe est supposé garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et définir les conditions de travail des magistrats. Selon l’article 122 de la Constitution, ses vingt membres sont nommés par le pouvoir législatif. C’est une fois nommés qu’ils élisent leur président, qui devient aussi président du Tribunal Suprême pour cinq ans. Conformément à la Constitution, les deux partis majoritaires au Parlement, le PP et le PSOE, se sont accordés pour désigner les vingt membres de l’organe. Mais le gouvernement a diffusé le nom du futur président, Manuel Marchena, avant même que les membres se soient réunis pour voter. A cette maladresse anticonstitutionnelle est venue s’ajouter la divulgation de messages diffusés via WhatsApp par un sénateur du PP, Ignacio Cosido, dans lesquels il se vantait du fait que le PP pourrait dorénavant « contrôler la justice » sur un ton humoristique extrêmement paternaliste.
Ces fautes sont donc venues fragiliser l’appareil institutionnel à la veille d’un procès majeur pour la démocratie espagnole où seront traduits en justice des dirigeants ayant menacé l’unité institutionnelle et violé la Constitution, et dont le discours repose sur une critique mensongère de la qualité démocratique de l’Etat espagnole et sur une remise en cause de la monarchie constitutionnelle. Face à cette situation, la stratégie de Pedro Sanchez est de moins en moins compréhensible. Plutôt que d’aller son électorat traditionnel parti vers Ciudadanos, il semble s’acharner à rester au pouvoir, même s’il parait aux yeux de l’opinion publique négocier sous la table des accords secrets avec les partis nationalistes en échange de leur soutien. Cela débouche sur une situation improbable : Pedro Sanchez poursuit les discussions avec les mêmes députés nationalistes qui ont insulté et craché sur un de ses ministres les plus expérimentés.
L’erreur politique de Pedro Sanchez est de conforter Albert Rivera, le porte-parole de Ciudadanos. S’il avait su représenter une défense solide de la Constitution, tout en assurant la réforme et l’approfondissement du modèle territorial décentralisé, qui reste un des grands acquis de la démocratie espagnole, il aurait pu combler cet espace constitutionnel de modération et récupérer certains des électeurs de Ciudadanos les plus incertains. Mais cette posture est dure à incarner alors qu’il semble gouverner de la main de nationalistes qui le ballotent. Dès lors, c’est Ciudadanos qui apparaît comme la seule option valide pour cet électorat de centre-gauche attaché à la Constitution, malgré le fait que ce jeune parti puisse montrer des pulsions re-centralisatrices.
Le 2 décembre, lors des élections régionales en Andalousie, le PSOE a été puni pour sa gestion, en perdant plus de 400 000 voix en trois ans dans ce fief socialiste dans lequel il gouvernait depuis 40 ans. Sans toutefois gagner les élections, Ciudadanos est passé de 9 à 21 députés en siphonnant au passage 10 députés au PSOE. A droite, le PP a perdu sept sièges, alors que l’extrême-droite, inexistante électoralement depuis la fin de la dictature, a remporté 12 sièges.
Les problèmes qu’affronte l’Espagne à l’heure de la célébration du quarantième anniversaire de sa Constitution sont multiples. D’un côté, la posture jusqu’au-boutiste du nationalisme catalan augure une augmentation de la polarisation et de la violence lors de la tenue du procès des politiques nationalistes responsables du référendum du 1er octobre 2017 et de la déclaration d’indépendance. La question du nationalisme catalan est donc loin d’être tranchée. De l’autre, et alors que les sondages n’augurent toujours pas de formation d’une majorité gouvernementale claire en cas d’élections législatives, le risque de la radicalisation des discours reste présent, à l’heure où l’extrême-droite resurgit. En 1978, les dirigeants politiques espagnols construisirent une démocratie grâce au dialogue et au consensus : la droite, le centre, les socialistes, communistes et même les nationalistes réussirent à s’assoir autour d’une table pour négocier. Le but était alors de répondre aux aspirations démocratiques d’un peuple, tout en contenant la menace qu’une classe politique franquiste et une armée réactionnaire pouvaient supposer. Quarante ans plus tard, cet héritage est menacé. Il est urgent de retrouver une classe politique responsable et réformatrice, qui sache mettre de côté ses dissensions pour donner à l’Espagne le futur enthousiasmant qu’elle mérite.
César Casino-Capian