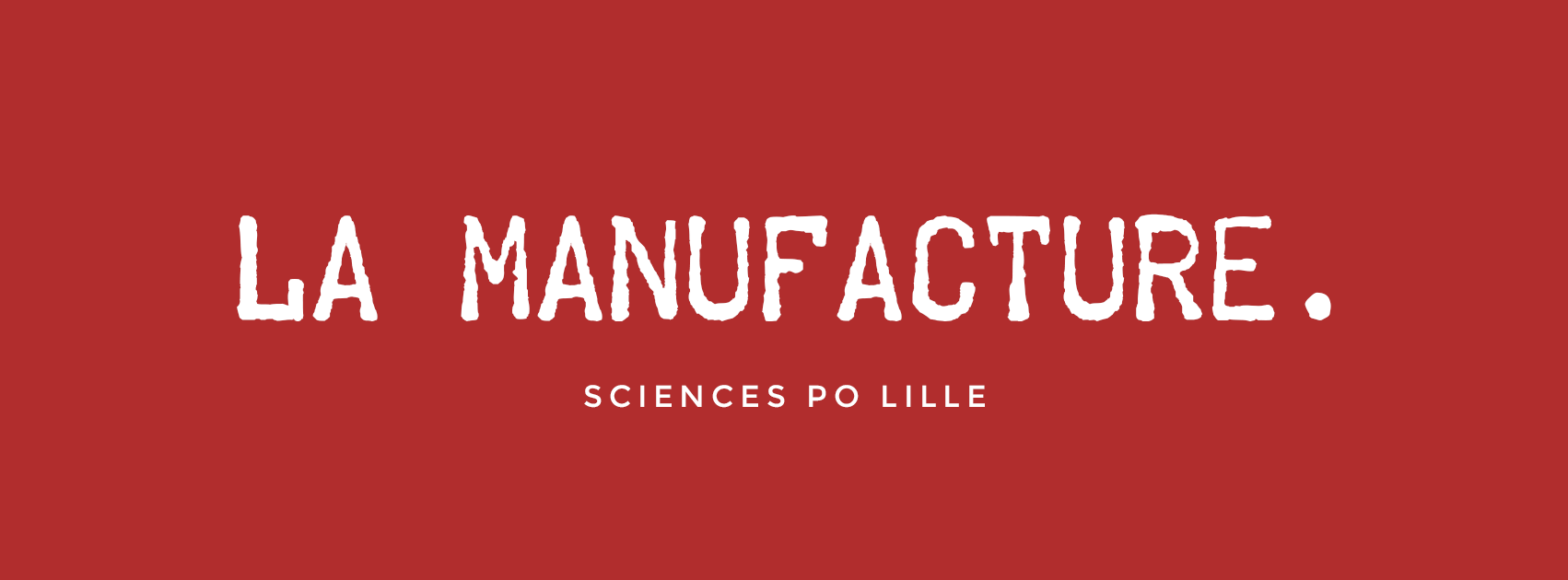Nous vivons une situation sans précédent : à l’heure où j’écris ces lignes, plus de la moitié de la population mondiale est contrainte de rester chez elle. Cet arrêt quasi-soudain des interactions humaines a eu pour conséquence inévitable de provoquer une crise économique dont l’ampleur nous échappe tellement elle paraît grande. Ces temps de restriction casanière nous invitent aussi à repenser notre modèle économique. Cette chronique est l’autopsie d’un crash, celui de l’avion portant notre économie mondiale.
Cher lecteur, afin d’égayer un semblant ta lecture, tu trouveras quelques GIF dégotés par ton dévoué serviteur/steward. Si lire cet article te semble trop fastidieux, reporte-toi au point “en bref” à la fin de l’article. Dans le cas inverse, je te conseille de te mettre du bon son pour accompagner ta lecture : de la psytrance, un bel exemple de contre-culture des années “hippies” revisitée sur une bande son électro — afin que tu sois pris·e d’un sentiment contestataire —.
La perte du moteur chinois
L’origine du virus est connue : un marché aux fruits de mer à Wuhan, ville quasi-inconnue du grand public “occidental”, malgré sa population de 11 millions d’habitants — six fois la population parisienne —. D’un virus localisé, une “simple grippe” due probablement au braconnage de pangolins, comment en est-on arrivé à une telle catastrophe ? Il faut dire qu’en l’espace de quelques semaines, ce virus qui s’est développé dans les alentours de ce marché a atteint un nombre très vraisemblablement sous-estimé de chinois·es.
L’épidémie a ainsi contraint la République populaire pour la première fois de son histoire à confiner ses habitant·es, d’abord la province du Hubei, puis d’autres régions. Un confinement à contrecœur, étant donné que la conséquence incontournable de ce massif “stay-home” est un arrêt quasi-instantané de l’économie chinoise. Une annonce désastreuse dans une économie en pleine expansion, bien que connaissant un relatif ralentissement de la croissance depuis deux ans. Un ralentissement qui a pu suffire à inquiéter les autorités de la première puissance commerciale, incapables pourtant de voir venir ce fléau.
Une succession de turbulences
Le confinement est pourtant intervenu trop tard, le mal est déjà fait. La carte interactive proposée par le New York Times (en anglais) nous montre qu’il a été aisé pour le virus de se propager. D’abord, l’emplacement du marché wuhanais : à proximité d’une station ferroviaire, une des plus empruntées de la ville. Aussi, les déplacements sont massifs en ce mois de janvier précédant le nouvel-an chinois.
Une année du rat, des porteurs de la peste. Même si cette expression a été infirmée scientifiquement, les humain·es, elleux, sont bien porteur·es d’un fléau. Un virus, bien moins visible qu’on a pu le croire dans un passé proche, bien plus dévastateur. Un virus qui a profité des interactions humaines, d’abord en Chine continentale, puis dans le reste du monde, pour se répandre, et causer une pandémie jamais vue en un siècle. L’économie, portée par les échanges inter humains, a aussi contribué à la prolifération de cette maladie à coronavirus.

Du crash/krach à la psychose
Reprenons du début : un virus inconnu et extrêmement contagieux, un environnement surpeuplé autour d’un hub, des flux massifs de population, voici les ingrédients pour une pandémie mondiale. Des flux humains stoppés brutalement par le confinement, qui sonne le glas de l’économie chinoise, du moins pour une durée qui semble limitée. En effet, le début du mois d’avril 2020 semble voir se relever la société chinoise, mais l’économie mettra davantage de temps à se remettre de ces deux mois sombres.
Un mot a pourtant fait redistribuer les cartes : l’interdépendance. Les liens commerciaux, les flux économiques sont si développés, que si une puissance chute, le monde entier s’écroule. L’Empire du Milieu, la première puissance commerciale, en voie de détenir le leadership mondial, est tombé. Les liens, d’abord infectés, sont désormais coupés. Les lignes de production sont interrompues. Les pénuries semblent arriver.
Le monde entier, d’un même mouvement, vacille. Les bourses chutent : en trois mois, -31% pour le CAC-40, le Dow Jones -27%, le Nikkei -23%. Les prévisions de “croissance” des États aussi chutent : la Banque centrale chinoise prévoit au mieux une croissance de 0% alors qu’en janvier l’estimation était de 5,9%. Les analyses s’accordent aussi pour une baisse du PIB d’environ 2%, tant aux États-Unis que dans la zone Euro. Le chômage semble exploser : le nombre d’inscrit·es au chômage au pays de Trump a été de 6,6 millions entre les 22 et 28 mars, 3,3 millions entre les 15 et 21 mars — les pics même durant les chocs pétroliers et la crises des subprimes n’ont jamais atteint le million de nouveaux chômeur·es hebdomadaires —. Un désastre alors que l’économie commençait à peine à se remettre de la crise de 2008.
La mondialisation, le coupable trop facile ?
C’est pourtant le premier désigné. D’aucuns diront « La mondialisation des échanges a fait venir ce virus chinois ici ». En effet, les échanges sont vecteurs de transmissions de maladies, notamment un tel virus aussi contagieux. D’autant plus que son caractère parfois asymptomatique l’a rendu d’autant plus redoutable.
Mais la faute ne doit pas reposer intégralement sur cette accélération des flux. Il n’a pas fallu attendre une mondialisation aussi poussée que la nôtre pour que la grippe venue des États-Unis en 1918 n’infecte cinq cent millions de personnes — plus du quart de la population mondiale de l’époque — et ne tue jusqu’à 100 millions d’humain·es. Même si les moyens de communication entre les différentes régions du monde se développent, ils n’allaient pas aussi rapidement que nos avions modernes à titre d’exemple. Aussi, les échanges à l’époque n’étaient pas d’une telle ampleur. Enfin, le monde de l’époque se rapprochait davantage des roaring years de la première moitié de l’entre-deux-guerres. 1929 était encore loin.
Des pilotes peu préparé·es face à la catastrophe
La crise sanitaire nous a déjà montré à quel point certain·es dirigeant·es ont pu faire preuve d’incompétence dans sa gestion. Certains pays ont pu endiguer rapidement la crise par des vagues de tests, d’autres se sont laissés submerger. La question du confinement, longuement posée, a souvent mis du temps à être appliquée. Trop longtemps. Les gouvernements ont aussi tardé à lancer la production massive des moyens de protection — gel hydroalcoolique mais surtout masques —. Certain·es déplorent que des États n’aient pas réquisitionné leurs chaînes de production, nous laissant dépendant·es des marchés extérieurs, qui ressemble davantage à un État de nature où chaque pays joue pour sa pomme.
Bien qu’ici la problématique soit économique, les décisions politiques auraient pu permettre que cette nouvelle maladie à coronavirus ne touche pas autant l’économie. Aucun acteur économique, aucun État, aucune organisation de la gouvernance économique internationale, aucun acteur privé — banque ou investisseur — n’a cherché à contrer efficacement les krachs qui ont rythmé les mois de février et mars.
Il a fallu attendre quinze jours avant que l’Europe à travers la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ne débloque les premiers fonds afin de relancer l’économie, suivie de peu par le président américain, Donald Trump. Des mesures keynésiennes, telles qu’on a pu voir en 2008 sous l’administration Obama et sous la gouvernance Trichet, aujourd’hui accompagnées de fermetures de frontières — rendant mathématiquement plus efficaces ces mesures de relance, afin de redynamiser l’économie à l’échelle de la zone monétaire —. Pour autant, ces mesures n’ont empêché l’arrivée du virus suffisamment tôt. Il était déjà trop tard.
Les coronabonds, une solution précaire
L’idée vient du Président du Conseil italien, Giuseppe Conte, soutenu par Macron — même la chancelière Merkel ne s’opposerait pas formellement au projet ! —. L’objectif est d’émettre des obligations pan-européennes — en clair, vendre de la dette — afin de faire front collectivement à la récession qui s’annonce. L’idée ne semble pas mauvaise : mutualiser les dettes entre pays utilisant la même monnaie, alors que les taux d’intérêts différenciés ont failli coûter l’économie grecque en 2010. D’autant plus qu’un endettement permettrait de redynamiser la consommation européenne, qui est globalement un foyer de consommateur·es : la zone euro pourrait ainsi mener la relance mondiale.
Il est pourtant nécessaire de questionner ce fonctionnement. Les plans de relance en 2008 ont essentiellement concerné les banques, et pas directement les consommateurs : l’enjeu était d’éviter une banqueroute généralisée. Pour certain·es, la lecture est que les États se sont endettés au profit des banques, qui ont à leur tour spéculé, et le résultat est ce nouveau krach. Il serait ainsi nécessaire d’aller plus loin.
EN BREF : Reconstruire un nouvel avion, de nouvelles économies
L’interdépendance entre les puissances a changé la donne.
Bien que la mondialisation ne soit pas la seule raison de la diffusion des crises sanitaire et économique qu’on subit aujourd’hui, il est temps de la questionner. Le journal italien La Repubblica titre son interview avec l’économiste écologiste Jeremy Rifkin, “La mondialisation est morte et enterrée” (“La globalizzazione è morta e sepolta, la distanza sociale sarà la regola“, lien vers l’article Rep: en italien). Pour lui, l’ensemble des pans de la société doit être repensée, dont l’économie qu’il veut “glocal” — à mi-chemin entre le global et le local —. On voit déjà globalement des levées de boucliers : fermeture des frontières, recours à la production locale favorisé.
De la redéfinition de nos modèles économiques
Au delà de la simple mondialisation, il est nécessaire de repenser notre modèle d’avion en lui-même : le capitalisme néolibéral. La banque d’investissements Natixis, filiale du groupe BPCE — Banque Populaire Caisse d’Épargne, le 2e groupe bancaire français —, publiait un rapport le 30 mars au titre éloquent : “La crise du coronavirus sonne-t-elle la fin du capitalisme néolibéral ?”. Difficile à croire, venant d’une banque, mais elle annonce bien la fin de notre modèle économique sacro-saint auprès de nos dirigeant·es. Le rapport des économistes de Natixis montre tous les signes qui pour elles seraient la preuve de la faillite du néolibéralisme.
“Tout ceci signifie bien la fin du « capitalisme néo-libéral » qui avait choisi la globalisation, la réduction du rôle de l’Etat et de la pression fiscale, les privatisations, dans certains pays la faiblesse de la protection sociale.”

Nous sommes dans l’oeil du cyclone
Nous vivons une crise économique dont nous ne percevons pas encore les conséquences dans leur entièreté. La pandémie mondiale accapare toute l’attention — à juste titre —. Peu de politiques osent s’aventurer sur le terrain plus que jamais glissant de la déflation qui nous attend. Les déclarations de Bruno Le Maire, ministre français de l’économie, sont peu claires. En effet, entre sa volonté d’un “nouveau capitalisme”, l’annonce d’un “redressement (…) pénible et coûteux” superposé à des éléments de langage rassurants : tout ça semble dévoiler une forte incertitude quant à l’avenir, même à Bercy.
Pourtant, l’oeil du cyclone est bien le seul atout que nous détenions actuellement. C’est le moment de définir une nouvelle stratégie. Un nouveau modèle économique qui viendrait en remplacement du capitalisme néolibéral qui vient de montrer explicitement ses failles. Quant au futur, il nous faudra survivre au reste du déluge.
Julien Quintin