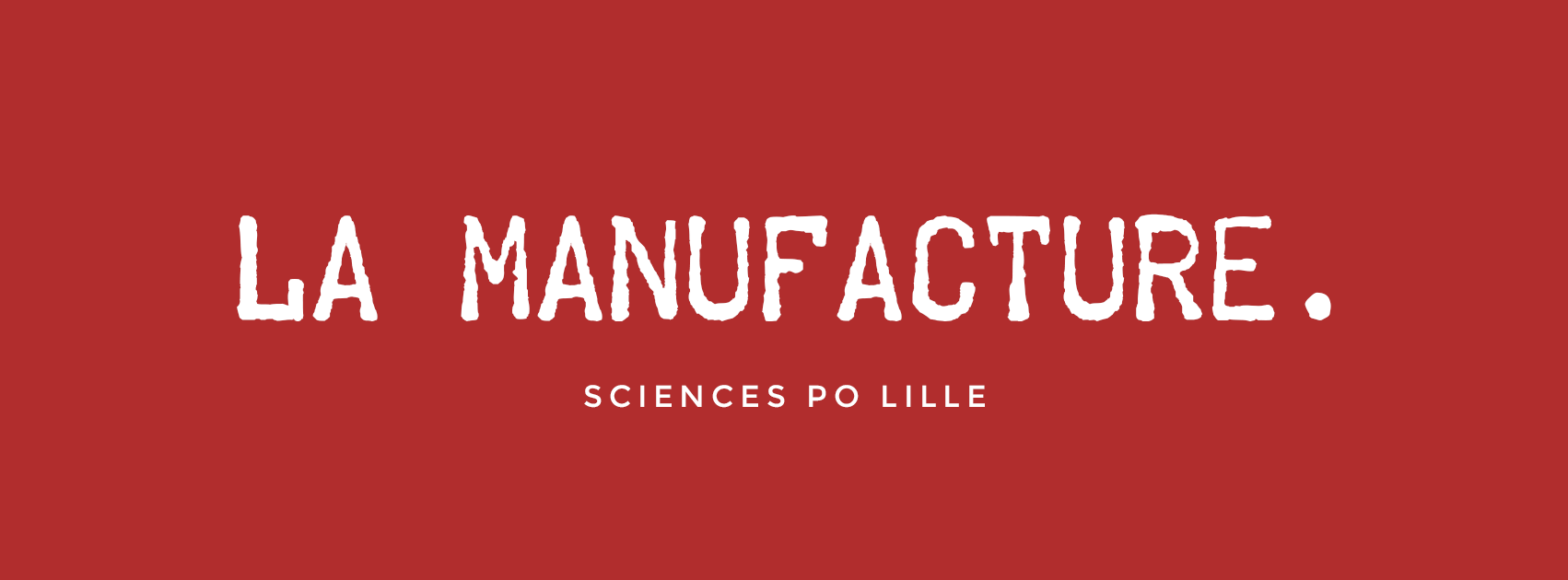Ce vendredi, Stéphane Beaud et Gérard Noiriel publient Race et sciences sociales : Essai sur les usages publics d’une catégorie” (Ed. Agone). Le premier, nouveau professeur titulaire à Sciences Po Lille depuis la rentrée, revient pour La Manufacture, sur son parcours qui l’a amené à devenir enseignant-chercheur en sociologie puis aborde ensuite les enjeux de ce nouvel ouvrage qui n’a pas manqué de faire réagir. Un livre qui soutient que la question de la race, portée par un militantisme politique, est devenue trop envahissante y compris dans les sciences sociales, au point de négliger la complexité sociologique.
Pouvez-vous revenir rapidement sur votre parcours universitaire avant votre arrivée dans le Nord ?
J’ai soutenu une thèse un peu sur le tard en 1995 (j’avais 37 ans) à l’EHESS sous la direction de Jean-Claude Chamboredon, mais largement sous la direction informelle de mon autre « maître », Michel Pialoux, sur les transformations du monde ouvrier en enquêtant à Sochaux-Montbéliard qui se nomme L’usine, l’école et le quartier.
Après un premier poste dans la foulée à Nantes, et dix ans comme maître de conférence puis Professeur en sociologie, j’ai eu l’opportunité en 2007 de postuler à Normale Sup’ (ndlr : l’Ecole Normale Supérieure) pour prendre la succession de Christian Baudelot. J’ai longuement hésité, c’est un poste à la fois prestigieux et compliqué à gérer. Finalement, j’y ai été élu professeur et y suis resté, sept ans : le cadre de travail, mes collègues (notamment Michel Offerlé et Florence Weber, les étudiants du Master PDI étaient « super ». Mais, pour des raisons difficiles à élucider et à dire, je restais constamment travaillé par le sentiment de ne pas y être vraiment à ma place. Bref, je suis revenu à mes premières amours : à la fac, à Nanterre, en science politique avant de revenir en province (je suis très provincial) pour un poste à Poitiers (2007-2010).
Je dis toujours aux parents parisiens qui veulent placer leurs enfants à Paris, “les Sciences Po de province c’est sûrement aussi bien, sinon mieux !”
Et donc, pourquoi Sciences Po Lille ?
Je suis en fin de carrière, ne me suis pas installé à Poitiers. Pour dire les choses brutalement, j’ai toujours cherché un juste milieu entre d’un côté Normal Sup où j’ai passé l’agrégation, ai été sept ans agrégé répétiteur en préparant ma thèse de doctorat – c’est là où je me suis vraiment formé à la sociologie, avec des professeurs formidables – et d’un autre côté, l’université que je défends théoriquement mais… En deux mots, à Poitiers, j’avais un peu l’impression de faire peur aux étudiants (j’ai écrit des livres, tout ça). J’avais très peu de demandes d’encadrement de master j’ai eu – peut-être à tort – l’impression de ne pas servir pas grand-chose. Pour cette raison, je ne me voyais pas y finir ma carrière. Et il se trouve que j’avais fait la conférence inaugurale il y a deux ans ici à Sciences Po Lille sur mon livre La France des Belhoumi (La Découverte, 2018). J’avais trouvé le lieu superbe, j’avais beaucoup accroché avec Pierre Mathiot qui m’avait glissé dans l’oreille “si ça t’intéresse, pourquoi pas essayer de venir ici ?”. Quand j’ai su que deux postes se libéraient, j’ai tenté ma chance !
Cela malgré votre mauvais souvenir de votre passage à Sciences Po Paris en tant qu’étudiant… Alors qu’est-ce que vous pensez de l’évolution de Sciences Po et donc plus largement des IEP ?
Oui car quand j’ai fait Sciences Po Paris, c’était terriblement conformiste, avec tous des futurs énarques qui avaient 20 ans, mais 60 déjà dans leur tête. A côté, moi, je faisais du foot, j’étais un provincial, je me suis vraiment senti à côté de ce monde. J’ai eu une sorte de déprime pendant plusieurs mois. Aujourd’hui Sciences Po (Paris) a beaucoup changé. Quand j’étais à L’ENS, au Master on avait des étudiants qui venaient de Sciences Po Lille, Lyon, Toulouse, et je les ai presque toujours trouvé intéressants. Je dis toujours aux parents parisiens qui veulent placer leurs enfants à Paris, “les Sciences Po de province c’est sûrement aussi bien, sinon mieux !”. (sourires)
Un conseil pour les étudiant.e.s qui aimeraient s’orienter vers la sociologie ?
Le seul : de travailler ! A partir de l’an prochain, vous avez de la chance, un nouveau Master va faire son apparition : Analyse des Sociétés Contemporaines (ASC) dirigé par Cédric Passard, qui va être consacré à la sociologie politique. Et là vous pourrez « tester » car le principal à votre âge en 2A/3A c’est de savoir si on est fait pour ça. Faire de la sociologie/science politique, cela s’apprend. Surtout, il faut accepter d’être déstabilisé par la recherche car c’est différent d’un concours. Il faut accepter de ne pas savoir, de douter, etc… Et en Master, lors de votre premier travail de recherche, c’est là qu’aura lieu le premier véritable test. Si votre mémoire est vraiment bon, vos professeurs vont vous encourager à continuer dans le domaine, vous aiguiller vers une thèse qui vous intéresse.
Vous assurez le cours des premières années sur la sociologie du Covid-19 et pour les 2A, c’est le cours électif d’introduction à l’anthropologie. Quel lien peut-on faire entre ces deux-là ?
La crise sanitaire et le confinement empêchent beaucoup le travail d’observation. Or la définition même de l’anthropologie c’est d’être avec les gens, participer, observer. Il est donc très difficile de faire de l’anthropologie aujourd’hui. On peut surtout faire de la sociologie quantitative, avec des statistiques, car les données de terrain ne sont pas là. J’utiliserai donc beaucoup de chiffres dans mon cours de 1A. C’est toujours les conditions d’enquête qui déterminent l’enquête. Bourdieu a réussi à faire des enquêtes en temps de guerre en Algérie. C’est une sorte de prouesse, c’était culotté. Il a travaillé notamment sur les villages de groupement lorsque près de 2 millions de personnes furent déplacées pendant le conflit en dehors des villages ruraux vers des camps de regroupement. On soupçonnait les villages d’abriter les fellaghas.
On ne peut pas en permanence dire que tout est racialisé, faire la racialisation de tout. Il faut étudier de près les diverses modalités de construction des individus.
Vous parlez beaucoup de l’importance du terrain dans vos travaux, le livre à paraître avec Gérard Noiriel est un peu différent ?
Oui, c’est un livre particulier moins centré sur une enquête de terrain. Il y a deux parties : celle historique de Noiriel, et la mienne plus ethnographique. Le point de départ est l’analyse critique d’un scoop de Mediapart à partir d’un travail de terrain pas aussi approfondi, car je travaillais simultanément sur le football à l’ENS. Il y a différentes façons d’enquêter. En parlant de football justement, dans le bouquin que j’ai fait sur la grève des Bleus en 2010, il n’y a pas un gramme de terrain car c’était inenvisageable. Il ne s’agit pas de fétichiser le terrain mais d’ajuster les outils à l’objet de l’enquête. Quand on veut travailler sur les “imposants” comme on dit, on a beaucoup de mal à faire de l’observation. Donc on récupère ce qu’ils écrivent par exemple.
Pourquoi cette association avec Gérard Noiriel ?
Avec Gérard Noiriel, c’est d’abord une rencontre, lorsqu’il est arrivé en tant que jeune docteur à l’ENS, j’étais étudiant. J’avais lu son maître ouvrage issu de sa thèse, Longwy Immigrés et prolétaires (1984) pour l’Agreg. Avec Les Ouvriers dans la société française (1986) et le Creuset Français (1988), trois de ses livres absolument majeurs en six ans, j’ai d’abord eu un rapport d’admiration pour l’historien. Puis de 1989 à 1994 on est devenu collègues à l’ENS et amis. J’ai toujours lu avec passion ces ouvrages. Ce livre que l’on a fait ensemble, c’est une sorte de réaction d’énervement par rapport à cette thématique devenue « envahissante » de la race en sciences sociales car elle est portée par un militantisme politique, qu’on peut comprendre bien sûr… Mais on a tenu à rappeler dans ce livre, les règles de base de méthode des sciences sociales. On ne peut pas en permanence dire que tout est racialisé, faire la racialisation de tout. Il faut étudier de près les diverses modalités de construction des individus.
Rokhaya Diallo a par exemple tweeté que c’était “honteux de relayer ça”, en s’adressant à l’Observatoire des inégalités : je ne vois pas de quel droit elle peut se permettre ce jugement-là ?
Un extrait est d’ailleurs paru dans Le Monde Diplomatique mi-janvier. Et il n’a pas manqué de lancer une polémique, certains vous accusent notamment de “réductionnisme de classe”, c’est-à-dire de mettre au second plan des inégalités attribuables à la race, au genre, ou autre, pour privilégier seulement la classe.
Le problème c’est qu’on est là en plein dans le mélange des genres entre la science et la politique. Quand on fait de la sociologie, quand on est chercheur en sciences sociales, on peut avoir nos convictions politiques, qui sont transparentes dans les objets qu’on traite, elles sont visibles. Mais il ne s’agit pas de les mettre en avant tout le temps. Et puis, il y a le champ politique, militant, où vous avez des personnes, tout à fait estimables par ailleurs, qui s’investissent dans des causes, qui les défendent avec leurs arguments mais qui tiennent des discours sans utiliser les outils des sciences sociales. Donc il y a forcément parfois une antinomie.
Rokhaya Diallo a par exemple tweeté que c’était “honteux de relayer ça”, en s’adressant à l’Observatoire des inégalités : je ne vois pas de quel droit elle peut se permettre ce jugement-là. Bien sûr, tout texte est soumis à la critique, mais là il y a un mélange des genres. On ne peut pas accuser quelqu’un d’avoir écrit un texte honteux à partir d’un point de vue militant parce que notre point de vue ne correspond pas au point de vue militant. C’est ça l’enjeu de ce livre, on est assez pessimistes sur la possibilité d’un débat avec ces militants d’ailleurs. La conclusion de celui-ci le montre, on fait ce livre pour les jeunes générations pour dire “attention à ces excès de vitesse interprétatifs, faisons des sciences sociales plus que jamais et ne nous laissons pas guider uniquement par des causes militantes”, même si encore une fois, elles sont sans doute légitimes, c’est évident. Le récent épisode du passage à tabac de Michel Zecler par quatre policiers dangereux et irresponsables, ça donne évidemment du grain à moudre à tous ceux qui pensent que tout est affaire de race dans la société française. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier la science.

Cependant vos travaux de sociologue sont éminemment politiques. En faisant des sciences sociales, est-ce que l’objectif est d’apporter quelque chose au débat politique ? Notamment d’ailleurs pour 2022 où ce thème en particulier a de fortes chances d’être central.
Si on prend l’exemple de travaux sur l’immigration, comme mon bouquin sur les Belhoumi (La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-2017), La Découverte, 2018) ou même les travaux de Noiriel, d’Abdelmalek Sayad, ça fait quarante ans que les chercheurs en sciences sociales disent la même chose. Il faut étudier les questions d’intégration d’un point de vue sociologique et cela renvoie à des conditions sociales d’insertion par l’école, le travail, etc… Il y a une partie des jeunes, de cité notamment, qui sont mis de côté, ou qui se mettent de côté parce qu’ils sont en décalage. Et là les chercheurs affirment qu’ils ne sont pas inassimilables, on montre les conditions naturelles non pas d’assimilation mais d’intégration des immigrés. Et cela, c’est dit depuis quarante ans. De l’autre côté vous avez la propagande du Front National, qui va durcir les choses en disant qu’ils sont inassimilables. Avant c’était parce qu’ils étaient musulmans, maintenant c’est parce qu’ils sont islamistes.
Les vrais porte-paroles des habitants des cités ne sont pas là. Ils sont « parlés » par des personnes, comme Camélia Jordana.
Donc au départ c’est ce que l’on cherche à faire : essayer de peser sur les termes du débat politique. Mais on s’aperçoit avec beaucoup de modestie, et parfois de tristesse, que c’est difficile, car les « politiques » n’ont d’yeux que pour les sondages d’opinion, la plupart n’ont pas le temps de lire autre chose. J’ai des copains qui étaient au PS, qui ont lu nos bouquins, mais malgré ça, j’ai fait un jour avec Pialoux un débat au fin fond du Sénat avec une partie des socialistes sénateurs sur notre bouquin Retour sur la condition ouvrière. C’était frappant pour moi : la plupart d’entre eux n’écoutaient pas, ils étaient tous avec leurs smartphones, leurs machins : ils ne s’intéressaient pas fondamentalement à ce travail. Donc c’est compliqué. Pour la gauche, pour le renouveau de la gauche, c’est à mes yeux fondamental qu’il puisse y avoir comme il fut un temps, des vrais dialogues entre chercheurs et politiques.
Vous parlez d’un principe de “consubstantialité” en sociologie, entre le genre, la race et la classe. Trouvez que la question de “la race” a supplanté celle de la classe, justifiant là ce besoin d’un renouveau à gauche ? Faut-il opposer finalement les luttes identitaires et les luttes de classes ?
C’est une question très compliquée. Il y a une objection – à prendre en compte- que l’on nous a faite dans cet article du Monde Diplo c’est de nous dire qu’on mythifie la classe ouvrière. Les classes populaires étant aujourd’hui éclatées, elles n’ont pas l’unité qu’on a connue quand on travaillait à Sochaux. Mais on a écrit là-dessus, le dernier chapitre de Noiriel s’appelle “L’éclatement de la classe ouvrière” : on est au courant de tout ça. Simplement, il faut essayer de repérer dans les mondes sociaux d’aujourd’hui quelles sont les dynamiques les plus fortes, fondamentales. La mobilisation sur le genre est centrale, forte et entièrement légitime parce qu’effectivement il y a eu réellement un tabou qui a sauté avec la force du mouvement « MeToo ».
Sur la race, c’est plus compliqué. D’abord, je ne connais pas encore de travaux, bien faits, sur les mobilisations des comités antiracistes. Ce qui me semble intéressant, c’est de travailler justement sur la sociologie de ces acteurs représentant les mouvements antiracistes. J’ai lu par exemple dans Mediapart récemment un grand éloge de Camélia Jordana, la chanteuse et actrice qui incarne un combat militant entre genre et race. C’est intéressant, bien sûr, mais ça l’est aussi de savoir qui elle est socialement. Elle appartient une troisième génération d’immigrés, issue d’une famille relativement favorisée, assez intellectualisée. C’est ça qui m’intéresse dans cette question-là : qui sont les porte-paroles de ces mouvements antiracistes ? Et les vrais porte-paroles des habitants des cités ne sont pas là. Ils sont « parlés » par ces personnes, et c’est ça qu’il faut étudier comme sociologue. On pourra avancer alors… Mais pour l’instant je ne vois pas beaucoup de textes intéressants là-dessus. Sur ces questions-là on reste, à mon avis, un peu trop prisonniers de débats purement militants.
Même si Ribéry n’est pas un agrégé de grammaire, on n’a pas le droit d’être aussi méprisants !
Pour finir, le football a pris une grande place dans votre vie, vous l’avez pratiqué jusqu’à 18 ans. Et il a, d’une manière assez originale, pris une place importante autant dans vos travaux de sociologie que d’anthropologie. Comment avez-vous réussi à le justifier comme un réel objet à étudier ?
Quand j’ai réalisé ma thèse (1990-96), la légitimité était centrée à l’époque sur la classe ouvrière, les classes populaires, le travail, etc… Le foot quant à lui était vraiment un objet dérivé, pas très intéressant et très largement délégitimé par les intellectuels. Mais ça me titillait déjà en 1991, où j’avais écrit un article dans XXème siècle avec Noiriel. Puis il y a eu en 2010 cette histoire de la grève de Knysna lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et le scandale dû au fait que les Bleus ne voulaient pas sortir du bus. Et ça a percuté mes objets de recherche : le foot et surtout le destin d’enfants d’immigrés qui surgissait dans l’espace public, qu’on avait étiquetés comme “des mauvais Français”.
J’ai donc eu une sorte de coup de sang si l’on peut dire, à la vue de cette pluie d’insultes qui s’est abattue sur eux : ce n’était pas possible de parler de ces gens-là comme ça. Même si Ribéry n’est pas un agrégé de grammaire, on n’a pas le droit d’être aussi méprisants. Le mépris de classe, le mépris social, m’a toujours préoccupé. Il y avait d’un côté la manière dont on parlait de ces footballeurs, et ce que je savais d’eux, de leur histoire, et donc c’est ça qui m’a intéressé pour mener mon enquête (Traîtres à la nation ? Un autre regard sur la grève des Bleus en Afrique du Sud, La Découverte, 2011). En termes de valeurs, c’est ce qu’apporte le point de vue sociologique, anthropologique, que tous les individus soient égaux lorsqu’on les interroge, lorsqu’on les écoute.
Petit à petit l’objet du football se légitime en sciences sociales : sur les dix mémoires que je dirige, au moins quatre traitent du foot cette année à Sciences Po Lille. Il faut du temps pour contrer ces effets d’institutions et de légitimité universitaire, mais on y arrive.
Parmi toutes les villes où vous avez étudié, enseigné, travaillé, restez-vous alors supporter d’un club en particulier ?
C’est très intéressant mais en réalité je n’ai jamais été un supporter ! Le seul supportérisme remonte lorsque je passais mon bac, c’était St-Etienne. Donc je suis resté supporter des Verts, à jamais (rires) ! Mais par la suite j’ai été très déstabilisé quand j’allais voir des matchs et voyais les Marseillais qui ne regardaient pas le match mais pendant deux heures criaient et animaient le tifo. J’avoue que le supportérisme tel quel, j’ai un peu mal, ça ne me fascine pas du tout. Même si j’aurais aimé être dans une ville avec un vrai stade, comme Lens, St-Etienne, peut-être Lille parce qu’ils ne jouent pas mal ! Mais sinon, Paris, je n’arrive pas à les supporter. Je suis malheureusement un Parisien provincial, tout le temps entre les deux, je n’ai pas réussi à avoir un point d’accroche.
Propos recueillis par Thomas Ladonne et Clément Rabu